Temps de lecture : 15 minutes
Introduction : l’amour des listes

L’année 2022 touche à sa fin et, ayant à la fois le goût immodéré de l’écriture et le goût du jalon, ces périodes de fêtes – émotionnellement drainantes et plutoniennes à souhait – sont traditionnellement pour moi l’occasion de rédiger toute une série de bilans – du plus insolite au plus introspectif. Mon amour du bilan, qu’il soit rétrospectif ou planifiant, va de pair avec un amour tout aussi enfantin pour les listes, que j’adore dresser à propos de tout et n’importe quoi, et plus ou moins frénétiquement selon les degrés de névrose que je peux atteindre : j’en archive donc des milliers.
Parmi les dizaines de carnets que je conserve religieusement dans une entame de ma commode, toute une série d’entre eux sont des feuillets uniquement remplis de listes : de tableaux vus, de gratitudes exprimées, d’émotions ressenties, de couleurs de feuilles recensées, de profils socioculturels repérés dans la ligne 7 du métro, de vers et citations isolées, de courses, de choses à faire — à un certain moment de ma vie, j’avais tellement besoin d’ordre et d’objectifs atteignables que dans celles où j’écrivais ce que je devais faire dans ma journée, j’incluais même le fait de faire mon lit, de me brosser les dents, de boire un café le matin au réveil et un second à dix heures, ainsi que le fait de sortir de ma chambre pour aller parler à quelqu’un. Bref, ainsi soit dit, j’aime beaucoup les listes, je les trouve agréables et pratiques, et même si ma lecture des Notes de chevet de Sei Shonagon (un chef-d’œuvre profondément poétique et facile d’accès que je recommande également) m’a conduite à favoriser les listes de choses et d’émotions, je n’en aime toujours pas moins les bilans de l’année passée, et notamment les bilans de lecture.
De mes seize à mes vingt-quatre ans, j’ai consigné l’écrasante majorité d’entre elles sur Senscritique puis, parce que le site pour beaucoup de raisons m’était devenu trop douloureux à utiliser, j’ai laissé la consigne de mes lectures s’évaporer dans un lourd brouillard indéfini (qu’à vrai dire je n’apprécie pas). Je suis incapable de me souvenir de tout ce que j’ai lu cette année, et pour cela il est possible que de très beaux bouquins passent à la trappe de cet article : mais, en ouvrant mon blog, une des choses que je souhaitais le plus mettre en place était une certaine mesure du partage culturel, et de la recommandation. Alors voilà donc, triés par catégorie, le bilan de mes plus belles lectures de l’année 2022 — en espérant que certain.e.s d’entre vous y trouvent des idées ou de l’inspiration pour survivre à nos trous d’airs imaginaires (que je suppose ne pas être la seule à subir).
ROMANS
« Mâchoires », Monica Ojeda

« Mâchoires » de Monica Ojeda, jeune et prometteuse autrice équatorienne, est un roman ultracontemporain puisque publié en 2018 en Equateur et en 2022 dans sa traduction française chez Gallimard. Sombre, mystique et profondément sensoriel, ce roman quasi uniquement féminin met en scène deux femmes : Fernanda, quinze ans, étudiante d’un prestigieux lycée de filles catholique de Guayaquil, et sa fragile professeure de lettres Miss Clara, rebaptisée par ses étudiantes la Madame Bovary Latina. Lorsque l’intrigue s’ouvre, la première est retenue prisonnière, pieds et mains liés, dans une petite cabane enfoncée dans la jungle équatoriale et, déroulant patiemment le fil de ce qui a conduit à ces sévices et à sa prise d’otage, une troisième figure de fille, à la fois plus sombre et plus claire, finit par faire son apparition : celle d’Annelise, une étudiante brillante aux allures de prêtresse sadique qui est aussi la meilleure amie d’enfance de Fernanda.
Lu en mai dernier, mon histoire de « Mâchoires » de Monica Ojeda et l’appréciation que j’en ai tirée est intimement liée à un processus d’écriture personnel puisque ce roman m’a été recommandé par Isabelle Sorente, autrice avec laquelle j’ai eu la chance de suivre toute une série d’ateliers d’écriture lors du second semestre 2022[1]. Il m’avait été soufflé que la lecture m’en serait bonne et utile car j’étais à l’époque engagée dans un processus d’écriture qui travaillait également l’idée de dévoration. Quoique mon travail concernait alors un type de dévoration tout à fait différent, la lecture de « Mâchoires » fut pour moi bouleversante dans sa façon de travailler en lignes parallèles de mes propres imaginaires littéraires les intrications de l’amour, de la possession, de la bouche, et de l’horreur.
Ce troisième roman de Monica Ojeda, à l’écriture aussi obscure que flamboyante, creuse en un délié très fin toute une série de thèmes symptomatiques de la construction adolescente de nos imaginaires contemporains, naviguant entre horreur réelle et transmise (notamment à travers le thème des creepypastas sur internet mais aussi de la façon dont le besoin anthropologique de ritualisation peut s’exprimer à partir d’elles dans les imaginaires adolescents) et extase vécue et désirée (à travers la recherche de sensations, de souillure des toiles blanches, et de la volonté de morsure).
Ce qui fait la valeur de ce roman aux allures de thriller psychologique et de roman gothique hispanophone, outre l’apport de pensées à propos de l’érotique, de l’horrifique et du quasi mysticisme de certaines pages, reste probablement la profondeur de la réflexion apportée par l’autrice à propos des rapports de transmission (et, donc, dans une certaine mesure, de dépassement inversé) entre femmes — que ce soit sous le prisme des rapports mère-fille, d’amie à amie ou d’enseignante à étudiante – le tout étant toujours amené de manière très subtile et sans jamais abandonner l’ambiguïté de l’extase et de la détresse dans ces échanges toujours organiques et souvent presque fluidiques.
Car à la lecture de « Mâchoires », et c’est ce qui a fini d’ancrer sa valeur à mes yeux, c’est l’aspect profondément sensoriel de l’écriture et de la narration de Monica Ojeda que l’on retient. Dès les premières pages, dans ce décor planté dans l’humidité obscure et touffue de la jungle aussitôt mise en rapport avec les entrailles du sexe et du pubis, « Mâchoires » devient un roman caverneux et poisseux, où le lecteur navigue à travers toute une jungle d’odeurs, de bruits de bouche et de sensations acides et tenaces. A cet égard, ce roman est pour moi l’un des seuls (avec le Roman d’Alexandre, chef-d’œuvre de la littérature médiévale[2]) qui réussit avec autant de finesse à coller dans la cervelle du lecteur toute une ambiance sensible d’images et d’odeurs, pour la plupart sombres, épaisses et huileuses. Pour cela, pour le plaisir de l’histoire – qui a également ce talent de tenir en haleine le.la lecteur.ice -, et pour l’intérêt des sujets apportés, je ne saurais que vivement en recommander la lecture.
A titre plus personnel, enfin, et parce que j’aime les récits emboîtés, je conserve précieusement cette joie de savoir que ce livre m’a été transmis également par une femme, et que celle-ci ait été pour moi une enseignante. Il est à notre tour perpétuel à tous de pénétrer dans les mâchoires du crocodile.
« Eureka Street », Robert McLiam Wilson
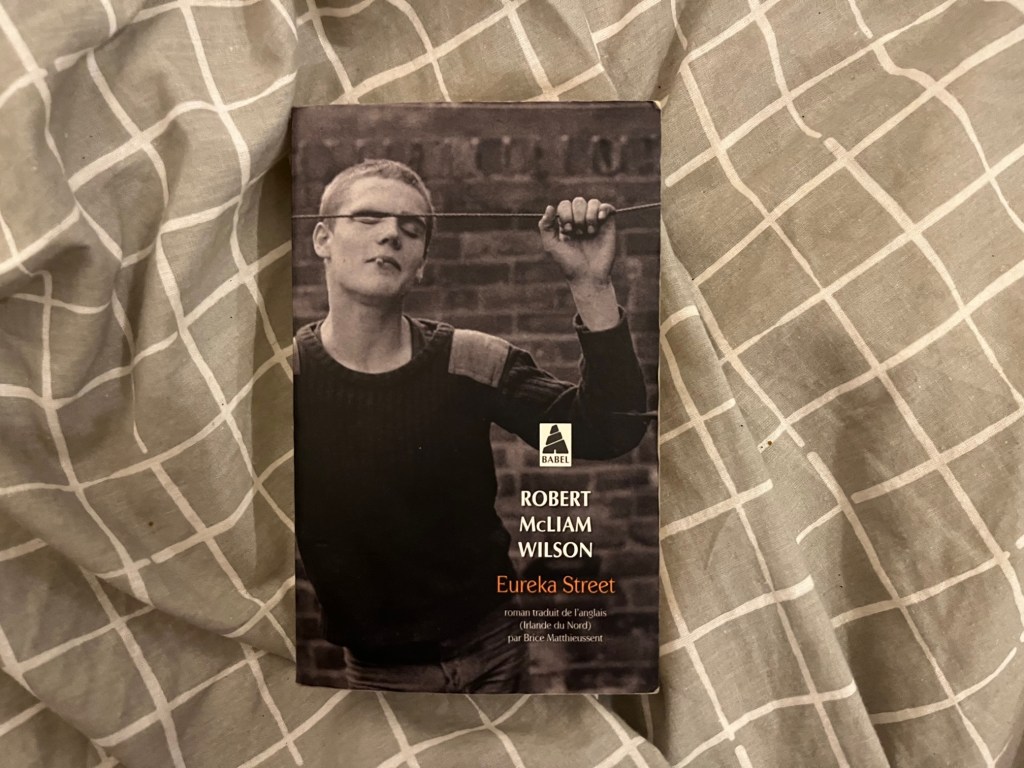
Un jour d’octobre de cette année, je me suis rendue à Etampes, petite ville de l’Essonne (qui a récemment connu un regain de popularité littéraire à la suite de la publication du « Voyant d’Etampes » d’Abel Quentin, que je n’ai pas encore entamé mais qui attends patiemment son tour sur ma commode) pour y retrouver O., une de mes meilleures amies, et sa copine M. qui s’étaient retrouvées dans l’obligation d’y garer leur van quelques temps à la suite d’un retrait de permis inopinément survenu au milieu de leur road-trip vers le Maroc. Arrivée à la gare une petite heure avant notre rendez-vous, j’en avais profité pour me balader dans les rues charmantes du centre-ville et, une fois n’est pas coutume, en avais profité pour visiter la librairie du coin (que je ne saurais que recommander car leur sélection était tout à fait admirable : il s’agit des Echappées, au 14 rue de la Juiverie).
J’avais pris pour la semaine suivante un billet d’avion aller/retour pour Dublin, à dire vrai sans enthousiasme particulier et sans attentes (je ne m’attendais pas alors au coup de cœur foudroyant que j’allais ressentir pour cette ville et pour l’Irlande, vaste sujet dont je ne parlerais pas aujourd’hui mais à propos duquel j’écrirai sûrement un article[3] un jour) ; alors, épluchant les rayons attentivement, j’ai dirigé mon regard vers l’étagère de littérature anglo-saxonne, espérant y trouver un classique de la littérature irlandaise qui m’aiderait à nourrir mon imaginaire avant d’embarquer pour ce nouveau voyage. J’avais déjà lu James Joyce et Seamus Heaney, aucun autre nom ne me venait en tête, et parce qu’il n’y avait pas de 4G dans la boutique (auquel cas j’aurais consulté des listes sur Senscritique, que je continue à utiliser dans ce cadre), je m’en suis remise aux bons conseils de la libraire, qui m’a immédiatement tendu un exemplaire de poche d’Eureka Street.
Au départ, j’ai reposé le volume, car le quatrième de couverture m’avertissait d’emblée que l’histoire se déroulait à Belfast, et que je trouvais hors sujet de m’embarquer dans un roman situé en Irlande du Nord – et je suis sortie me promener. Mais, pour une raison ou pour une autre (parmi lesquelles la couverture et ce qui était dit de l’intrigue), le livre continuait à me trotter dans la tête et, pressentant une belle lecture à venir, je suis rentrée quelques minutes plus tard dans la librairie et je l’ai acheté. Me le tendant, la libraire me dit que je n’allais pas le regretter, et elle avait raison.
Eureka Street, nom parmi d’autres porteur paradoxal de rêves au milieu d’une Belfast dévastée et rouée de coups, est une pièce du décor de briques rouges et de misères où évoluent les personnages de ce long roman. Bâti principalement (et de façon alternée) autour de deux personnages, Jake Johnson et Chuckie Lorgan, on pourrait dire que la capitale de l’Ulster en est un troisième tant les pavés de ses artères sont battus et rebattus par les hommes qui la peuplent tout au fil des pages. Située à l’époque des Troubles (1968-1998[4]), l’intrigue alterne et fait communiquer les meurtrissures : en miroir du conflit nord-irlandais, qui oppose catholiques et protestants et nationalistes et unionistes, ce sont les propres douleurs et rêves des protagonistes qui nous sont présentés sur fond de litres de bières bues et d’accrochages hasardeux.
Dans Eureka Street, conflits politiques et conflits interpersonnels n’ont de cesse de se répondre et de se dédoubler. Jake Johnson, catholique désabusé et bagarreur sentimental, est la voix en « je » d’une partie de la narration, où il déambule dans ces quartiers sales et miséreux en n’ayant de cesse de tomber amoureux et de s’ennuyer. La femme qu’il aimait, Sarah, a fini par quitter Belfast et sa violence et par le quitter lui du même coup ; alors Jake, pour tromper la guerre et la mort, se réfugie dans la bière, les potes et la baston, sans pour autant parvenir à ne plus voir ces successions de silhouettes faméliques et meurtries qui se succèdent à sa porte entre les slogans des partis opposés. L’autre moitié de la narration est portée par un narrateur omniscient, et se concentre sur Chuckie, l’un des copains de la bande, protestant au contraire de ses amis. Chuckie est un trentenaire bedonnant, rose, et lisse, au pénis anormalement démesuré, qui vit toujours avec sa mère. Un jour, il se réveille avec l’envie incongrue et persistante de gagner de l’argent, et finira multimillionnaire génial parvenant à séduire jusqu’aux plus grands PDG des Etats-Unis sans jamais très bien savoir ni pourquoi ni comment.
Par cette alternance des points de vue, Eureka Street oscille entre deux tons – qui ne se défont jamais de la dureté quotidienne de la vie à Belfast lors des Troubles -, toujours aussi cruels que poétiques et profondément empathiques. Le personnage de Jake, idiot intellectuel et romantique, est le vortex par lequel s’engouffre toute la compassion de l’auteur pour ces habitants d’Irlande du Nord toujours prompts à boire et à rire malgré l’absurde dureté de leur vie au milieu de ce conflit dont il semble que personne ne sait plus bien ce pour quoi il lutte ; quant aux chapitres consacrés à Chuckie, ils atteignent parfois une tournure si absurde que le roman prends presque des allures de farce – une farce qui n’a pas été sans me rappeler la profonde tristesse qui se cache toujours dans les sublimes romans d’Edgar Hilsenrath.
Eureka Street, pour le dire nettement, est une merveille. La virtuosité de l’écriture, portée par l’argot, la poésie, la violence, la vulgarité et la finesse, ne dévoie rien au plaisir de la lecture, rythmée par une narration aiguisée qui se passe des facilités de l’évènement. Chaque personnage est une merveille de complexité, qui ne s’alourdit jamais de discours mais se nourrit d’images et de réflexions glânées au hasard de la merde et des rues – méditations qui pour certaines m’ont émue aux larmes tant elles ont raisonné. Au-delà des connaissances historiques que ce roman m’a apporté (et elles furent bienvenues , donc, avant ce premier séjour en Irlande qui, quoiqu’il se situât en République, s’en est trouvé plus éclairé), c’est précisément là que se situe toute la grandeur de ce livre dont je n’avais (malheureusement) jamais entendu parler : malgré l’aspect tragique et désespéré du quotidien de ces loosers alcooliques et désabusés, Robert McLiam Wilson ne cesse jamais d’éclairer toute la crasse qu’il présente d’une immense, vaste et profonde traînée de lumière et d’humanité.
Il est rare de lire un roman qui réussit si parfaitement à se faire le jeu de la haine et de la compassion, du cynisme et de l’espoir, et – excusez l’aspect convenu de la formule -, du rire et des larmes. Par ailleurs, je considère qu’Eureka Street, par son aspect profondément narratif (il s’agit bien ici d’un pur roman, avec des personnages, un début, un élément perturbateur, une mise en action et une fin), et malgré son amplitude (496 pages en version poche chez Babel), reste un roman facile d’accès – et il m’a tant émue que je voudrais pouvoir le mettre dans toutes les mains que je rencontre.
Lorsque je suis retournée en Irlande – pour dix jours cette fois, à cheval entre novembre et décembre -, j’ai cherché Robert McLiam Wilson dans toutes les librairies que j’ai rencontrées sur mon chemin (et il y en a eu beaucoup, car d’une part il y a beaucoup de librairies en Irlande et car d’autre part dès que j’en croise une j’ai tendance à y rentrer) : et, à mon grand étonnement, je ne suis jamais parvenue à y trouver ni Eureka Street ni aucun de ses autres livres. Ca m’a surprise d’autant plus que l’auteur, également professeur à l’université d’Ulster et rédacteur pour Charlie Hebdo et Mediapart, a été largement récompensé pour son œuvre, tant à l’étranger qu’en Irlande, allant jusqu’à remporter le prix Rooney de littérature irlandaise en 1989. Le jour précédent mon retour à Paris, je me suis rendue au Museum of Literature Ireland de Dublin, qui fait face au St Stephen’s Green, et n’y trouvant toujours pas trace, ai fini par poser la question à l’un des gardiens du musée : il ne le connaissait même pas de nom.
J’espère, courant 2023, pouvoir me rendre en Irlande du Nord (il y a là-bas aussi tant de merveilles à contempler), et faire un détour par Belfast. Hasard ou non, Eureka Street, Hope Street, Poetry Street sont des rues qui – selon Google Maps tout du moins – n’y existent pas : mais, me baladant dans la ville, je ne manquerais pas de saluer avec émotion ces fantômes de papier auxquels l’écriture de Robert McLiam Wilson a permis de faire prendre chair dans mon esprit ; et je n’oublierais pas, également, de saluer Ripley Bogle, que je lis à l’heure où j’écris ces lignes et qui est un égal chef-d’œuvre de vie, de chagrin et d’humanité.
POESIE
« Du mouvement et de l’immobilité de Douve », Yves Bonnefoy

Plus que pour tout autre matériau littéraire, il me semble toujours difficile de composer un compte-rendu critique et de proposer une opinion objectifiable des recueils de poésie. Sans vouloir tomber dans toute une série de circonvolutions pesantes à propos de ce qui fait ou non le propre de la poésie (pour moi, pour les autres, pour René Char par exemple : le poème est l’amour réalisé du désir demeuré désir), elle me semble toujours difficile à défendre – comme à condamner. En un mot comme en cent : c’est beau (pour moi) ou ça ne l’est pas (pour moi, ou pour tous, selon le pôle axiologique littéraire que l’on choisit d’emprunter).
En ce qui concerne Yves Bonnefoy, il me faut avouer ma découverte extrêmement tardive de l’auteur : et cette (outrageuse) négligence de ma culture littéraire supposément tatillonne, je dois le dire, était un choix volontaire de ma part – dicté comme souvent par ce pédantisme des étudiants en lettres considérant qu’ils ont des centaines de chef-d’œuvre à lire avant que de ne prendre le temps de s’attarder sur les auteur.ice.s contemporain.e.s[5]. Première bêtise, puisqu’Yves Bonnefoy (1923-2016) appartient au spectaculaire 20ème siècle littéraire, et que « Du Mouvement et de l’Immobilité de Douve », sa première publication, paraît au Mercure de France en 1953 après que l’auteur ait pris ses distances avec le mouvement surréaliste, qu’il fréquentait auparavant. Premier coup dur, donc, pour mon snobisme académique qui dût en outre admettre sa défaite à propos de ses connaissances d’histoire littéraire.
J’avais, pourtant, entendu parler d’Yves Bonnefoy très jeune : c’était en Vendée. J’avais quatorze ans et nous étions partis, ma famille et moi, dans une petite maison de chaux au milieu d’un verger rempli de prunes et de mirabelles. Il avait plu toute la semaine, et j’avais eu tout le loisir donc de me consacrer à deux activités : faire des tartes aux fruits, et dévorer les œuvres intégrales de Shakespeare, pour lequel je m’étais prise d’une passion récente. Je me rappelle nettement mon père qui était alors venu me voir pour vérifier mes tomes, et m’avais vivement enjoint à lire au possible Shakespeare dans les traductions qu’en avait faites Yves Bonnefoy. Il m’avait dit qu’elles étaient les plus belles, et qu’Yves Bonnefoy était aussi un merveilleux poète[6]. Depuis lors, je n’avais considéré ses œuvres propres que comme un travail auxiliaire, et il était resté dans mon esprit ce « bon traducteur » dont je n’imaginais pas que le talent puisse excéder cette tâche.
Mais un jour, au milieu du mois de décembre, je suis tombée par hasard sur Instagram sur une photo d’un livre ouvert sur un poème splendide, qui a eu sur moi l’effet d’un charme ; quelques heures plus tard, je courais chez Gibert Jeune m’acheter « Du Mouvement et de l’immobilité de Douve » et, les cinq jours, suivant, j’ai pleuré d’émotion chaque matin face à la beauté de ce que je lisais.
L’immersion dans l’imaginaire, chez Bonnefoy, n’abandonne rien à la chose réelle, qui sert toujours à la fois d’ancre, de navire et de port d’attache. Ainsi, les images sont sensorielles – mouvantes, immédiates -, et si elles échappent à la compréhension des choses abstraites ce n’est que pour mieux faire la course à la beauté tangible du monde. Ainsi, la lecture de Douve s’apparente à une traversée, qui se fait main dans la main de l’écrivain mais aussi de cette femme protéiforme et allégorique qui se nomme Douve pour ne pas dire le rêve et mieux convoquer l’insolvabilité du problème de la mort. Disant à mon père que je lisais ce recueil, et que j’en étais bouleversée de beauté, il m’a répondu qu’il avait rarement lu poésies si belles, mais qu’il n’avait rien compris, et qu’il était toujours fasciné, et qu’il cherchait encore. Car qui est Douve, cette figure instantanée et ferreuse comme du vent, qui n’a de cesse de s’échapper lorsqu’on la touche et chaque fois qu’elle meurt ?
Ayant livré sa tête aux basses flammes
De la mer, ayant perdu ses mains
Dans son anxieuse profondeur, ayant jeté
Aux matières de l’eau sa chevelure ;
Etant morte puisque mourir est ce chemin
De verticalité sous la lumière,
Et ivre encore étant morte : ô je fus
Ménade consumée, dure joie mais perfide,
Le seul témoin, la seule bête prise
Dans ces rets de ta mort que furent sables
Ou rochers ou chaleur, ton signe disais-tu.
Yves BONNEFOY, « Le seul témoin I. », Du mouvement et de l’immobilité de Douve, Paris, Gallimard, Poésie, 1982, p. 67.
Douve est cette femme animale, minérale, végétale, celle de tous les règnes et de toutes les échappées : le poète, entraînant le.a lecteur.ice dans son sillage onirique et anxieux, n’a de cesse de la chercher et de la perdre. Pourtant, la façon dont le recueil est construit et progresse, semble apporter des éléments de réponse à ce mystère qui n’en attends pas : construit en cinq parties[7] (Théâtre – Derniers gestes – Douve parle – L’orangerie – Vrai lieu), dont les poèmes s’absolvent parfois de leur titre, l’ouvrage progresse vers un endroit juste, ce « lieu vrai » ou, conclut-il, « le jour franchi[ra] le soir [et] gagnera sur la vie quotidienne […] cette muraille des morts » (p. 113). Le seuil, pourtant, ne sera jamais tout à fait franchi.
« Du mouvement et de l’immobilité de Douve », au-delà de l’afflux de beauté qu’il a suscité – chez moi, au moins, et qu’il peut susciter chez tous je l’espère -, est l’une des plus belles réflexions que j’aie lu à propos de la mort, toutes catégories littéraires et réflexives confondues. Pour cela, au moins, et pour son caractère incontournable, il me semble mériter d’être lu par tous et toutes, et je ne saurai que le recommander plus que franchement – avec l’adoption de cette posture d’abandon du lecteur qui le convie à monter sur cette rade l’emportant nul ne sait où.
ESSAIS
« Marcher ou l’art de mener une vie déréglée et poétique », Tomas Espedal
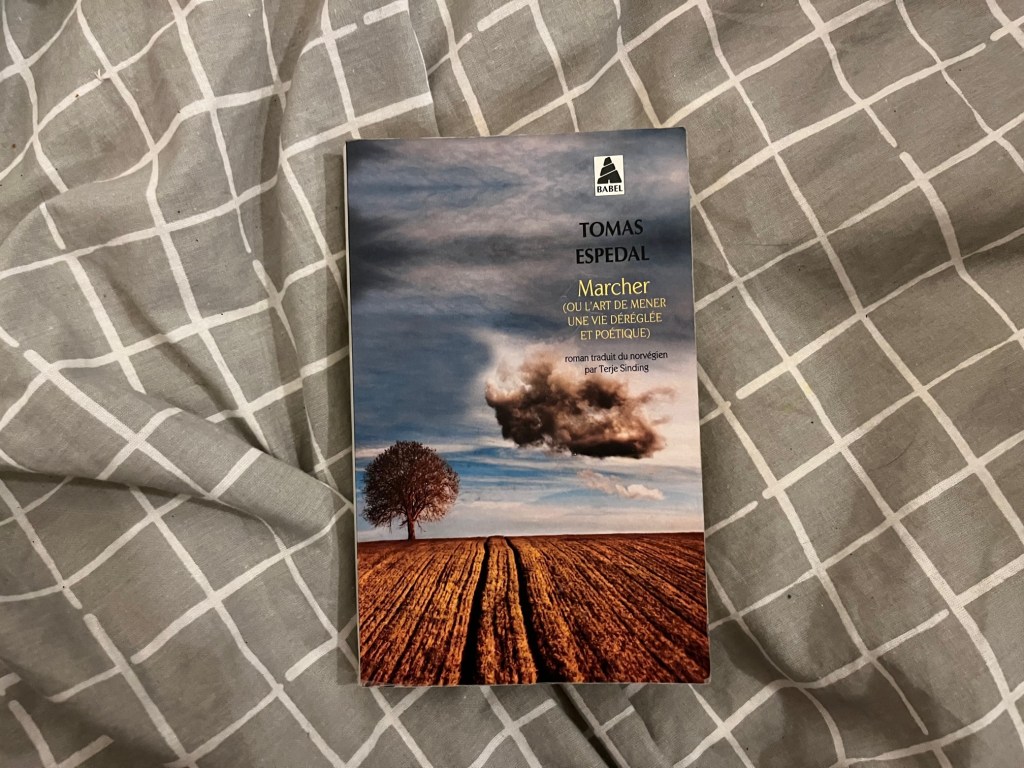
Pour ces deux dernières recommandations, j’irai plus vite – d’abord car je m’aperçois que mon fichier Word approche dangereusement des dix pages, et que je ne voudrais pas effrayer les deux lecteurs qui lisent mon blog quotidiennement – mais aussi car à mon sens les conseils de lectures d’essai tiennent principalement à l’intérêt que l’on peut porter à tel ou tel sujet abordé plutôt que dans l’apport que peut susciter ma réflexion sensible à leur sujet.
J’ai trouvé Marcher de Tomas Espedal sur un rayonnage de l’excellente librairie Tropismes, à Bruxelles, en mai dernier, et dès les premières pages j’ai su qu’il s’agirait d’une de mes plus belles lectures de l’année (voire plus), toutes catégories confondues. Sans vouloir tomber dans le pontife (mais le faisant quand même, et avec joie), Marcher ou l’art de mener une vie déréglée et poétique fait exactement partie de cette catégorie de livres dont on dit « qu’on aurait voulu ne les avoir pas lu pour pouvoir les redécouvrir une seconde fois » ; et les mots de Tomas Espedal ont eu cet effet sur moi dès les premières pages, donc.
Une vie de chien : ramper, à quatre pattes, ventre au sol, visage baissé, une cicatrice à l’œil, la lumière, elle frappe comme un bâton, une plaie dans laquelle on siffle, elle siffle dans le sang, ça siffle dans la tête, qui est-ce qui siffle, s’approcher de ça, ramper jusque sous la table, une flaque d’alcool, la boire en lapant, se rouler en boule et s’installer sous la table, tu vois tout à moitié ou à peine, le bas du torse peut-être, les pieds nus et, le soir, l’ourlet de sa chemise de nuit. […] La pièce vide, d’une nudité si apaisante, une lampe, oui, quelque chose à aimer, aimer une lampe, te déshabiller, éteindre la lumière et te mettre au lit, si seulement tu savais, comment peux-tu savoir, qu’est-ce que tu en sais, il sort une cigarette, se glisse sous la table, comme il est bon de ramper, de se noyer en soi-même. Comme il est bon de boire, de se remplir d’oubli, de se perdre et de sombrer. L’obscurité s’insinuant sous la table, comme si on vivait dans une maison à l’intérieur de la maison, lundi, mardi, jeudi, une niche de chien, tu sors en rampant, tu te glisses jusqu’au mur, tu enfonces l’ardillon de ta ceinture dans la prise électrique, voilà!, tu sens la lumière ? tu sens la force ? tu le vois maintenant se redresser, se diriger à tâtons vers la porte, lutter et bondir, sauter jusqu’à la poignée, l’attraper avec la gueule, la baisser avec les dents, le métal contre la langue, l’ouvrir en aboyant et courir dans le couloir, faisant tout le vacarme qu’il faut pour qu’on vienne le chercher.
ESPEDAL Tomas, Marcher (ou l’art de mener une vie déréglée et poétique), Paris, Actes Sud (Babel), 2012, pp. 14-15.
Au départ, un homme qui vient de rompre et ressent le besoin inextinguible de sortir de chez lui – et qui ne s’arrêtera plus de marcher. Ecrivain, professeur d’université, Tomas Espedal est également un ancien boxeur, ce qui se remarque dans sa prose brutale et ciselée qui ne se départit pas d’un certain romantisme pudique et mélancolique. Résolument ancré dans la figure des « mauvais garçons cultivés » (parmi lesquels on pourrait également mentionner Jean Genet ou Rimbaud, tous deux d’ailleurs abondamment cités dans Marcher), le pas posé au sol s’accompagne toujours des cloches de détresse et de la façon dont la lecture a pu les guider. A la fois essai sur les bienfaits de la marche et sur la philosophie du vagabondage, la première qualité de l’ouvrage – annoncée dès le sous-titre de celui-ci – tient en son caractère (très) richement référencé – en idées de lectures, en idées de sentiers à emprunter, en idées tout court et en désirs de mener cette vie déréglée et poétique qui apparaît tout d’un coup aussi réelle que capitale.
Appartenant au vaste sous-genre de la littérature de voyage, cet essai à mi-chemin entre le roman autobiographique, l’anthologie littéraire et l’ouvrage de philosophie (accessible), me semble pourtant bien souvent éviter ses écueils les plus courants. S’absolvant, par exemple, d’un romantisme naïf caractéristique des Bougainville, Flaubert et autre Nerval, ou d’un nostalgisme parfois quasi réactionnaire à la Sylvain Tesson – dont mon père a dit à juste titre qu’il parle parfois trop souvent de la marche pour mieux barboter dans ses propres réflexions introspectives à propos de lui -, Espedal utilise la route choisie pour parler des autres, et de ce que leurs mots ont pu embellir. Ainsi, on ressort de la lecture de Marcher avec l’envie folle de redécouvrir un nombre incalculable de GR, de villages et de livres – partout en Europe, et jusqu’en Turquie.
Outre la qualité littéraire hallucinante de la majeure partie de ce livre, le.a lecteur.ice ressort donc affamé de tout un tas de paysages et de récits – j’ai été, en particulier, fascinée et charmée par les descriptions de la Grèce, de la Norvège et des côtes turques qu’il m’a livrée -, avec une envie réussie à l’égard du projet du livre : celle de marcher – et de marcher une vie déréglée et poétique.
Il me faut absolument signaler, toutefois, que le choix de présenter ce livre dans cet article ne s’est pas fait sans réticences : car, d’abord – mais cela n’est pas grave -, il y a (à mon sens, et à celui de mon père, à qui j’ai offert le livre pour noël) un affaiblissement narratif et stylistique dans ce livre d’Espedal – à peu près au moment où il arrive à Paris, et effectue la marche d’Erik Satie – ; mais, ensuite, et surtout – et cela est grave, malheureusement -, « Marcher ou l’art de mener une vie déréglée et poétique » contient des épisodes problématiques – notamment des propos r*cistes ainsi qu’une scène de vi*l. Il convient donc d’en être averti.e.
« Entre Dieu et le cosmos », Raimon Panikkar – Entretiens avec Gwendoline Jarczik
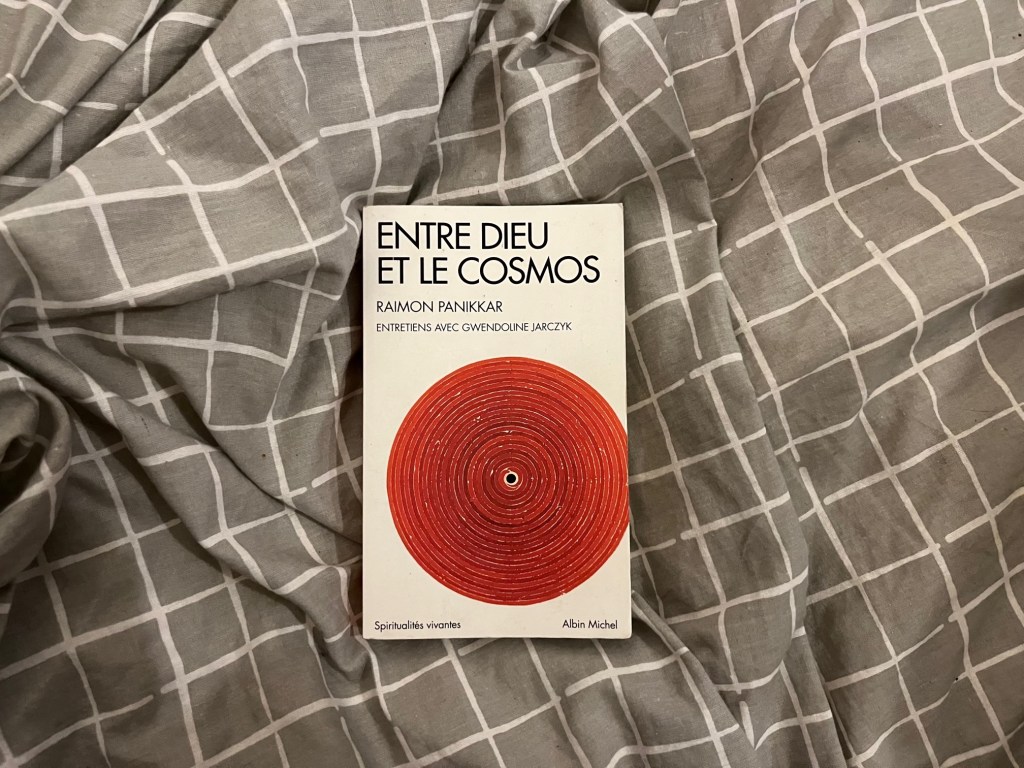
Cette dernière recommandation est un peu particulière, au point que je ne sais pas trop bien comment en parler tant les sujets qu’il aborde relèvent d’un domaine théorique particulier et intime : celui de la théologie et de la foi. J’ai choisi de présenter cet ouvrage malgré tout car, croyant.e ou non (et je ne le suis d’ailleurs pas), je l’ai trouvé clair, concis, et foisonnant de pistes de réflexions passionnantes à aborder pour peu que le sujet de la théologie catholique nous intéresse.
Puisque je me suis amusée, au cours de cet article, à retracer ci et là les lieux à partir desquels j’ai découvert tel ou tel livre – et cela a du sens pour moi car une lecture est avant tout et toujours l’objet d’une rencontre – qui se noue avec les hommes et les femmes, avec la poussière et les déambulations -, voici l’itinéraire qui m’a conduit à cette réunion : à Bruxelles, il existe une bouquinerie presque érigée au rang d’institution tant elle est immense et fréquentée et connue de tous. Il s’agit de Pêle-Mêle, dont la boutique mère se situe boulevard Anspach, entre la Bourse et la Gare du Midi. Les livres y étant nombreux et (très) peu chers, j’y ai mes habitudes depuis l’enfance[8] et, même depuis que j’ai déménagé à Paris, j’y retourne dès que j’en ai l’occasion – farfouiller entre les rayons, creuser entre les piles, choisir les volumes et me promener entre les bibliothèques est un plaisir tout propre à l’aspect chaotique et fourmillant particulier à cette bouquinerie.
En début d’année, alors que j’étais rentrée à Bruxelles pour le week-end, je faisais ma promenade habituelle dans les étalages quand je me suis arrêtée au rayon de théologie. Pour tout un tas de raisons (sur lesquelles je reviendrai sans doute, car l’expérience me semble suffisamment intéressante pour en faire un jour un article de blog), il se fait que l’année dernière fut marquée pour moi par une découverte fracassante – car totalement inédite et totalement vierge – de la spiritualité new-age et des sciences occultes. D’abord emballée à en mourir, dépensant tout mon temps et mon argent dans mon exploration des champs innombrables des pratiques ésotériques contemporaines (astrologie, alchimie, travaux de prédiction, manifestation, chamanisme, rapport à l’au-delà, et j’en passe), j’ai fini par m’éloigner nettement des formes nébuleuses que peut parfois prendre le rapport actuel à la spiritualité, un peu déçue sinon amère – pour des raisons tout aussi personnelles que politiques.
Mais la brèche du rapport au divin avait été ouverte, et mes réflexions métaphysiques à propos de la nature de la mort comme de celle de la vie s’en retrouvaient affamées et manquant d’eau pour les nourrir. C’est comme ça que je me suis spontanément redirigée vers la lecture des trois livres et, en particulier, vers celle de la Bible ; et que mon regard et mes pas se sont retrouvés attirés et charmés par les vieux volumes un peu kitsch du rayon théologie. Parmi ceux que j’ai pioché (dont également l’excellente lecture des Echos du silence de Sylvie Germain), il y avait ce volume d’entretiens de Raimon Panikkar et de Gwendolyne Jarczyk, spécialiste d’Hegel et de Maître Eckhart. La division en chapitres thématiques (l’existence du mal, la condition des femmes, l’institution de l’église, la nature de la vie éternelle,…) ainsi que l’apparente simplicité rhétorique finirent de me convaincre, et je repartit donc avec le livre.
Ecrivain, chimiste, théologien, catholique et hindou – non pas à moitié l’un et à moitié l’autre mais pleinement l’un et l’autre, nous explique-t-il dans une superbe première réflexion -, Raimon Panikkar (1918-2010) est un prêtre catholique indocatalan. Penseur brillant et follement érudit, il nous livre dans Dieu et le cosmos, par l’intermédiaire des questions non moins fines de Gwendolyne Jarczyk, une série de réflexions passionnantes à propos de ce qu’il appelle le cosmothéandrisme. Concept construit pour mieux appréhender sa propre vision u réel, le cosmothéandrisme pose la réalité comme n’étant pas un bloc unique ou séparable en trois dimensions que la tradition convient de distinguer (divinité, spiritualité, matérialité), mais comme une relationnalité en soi faisant le pont et le dialogue permanant entre ces trois pôles (transcendance, conscience et matière) – relationnalité qui fait bien sûr écho à la célèbre trinité chrétienne, ce qu’il explique très bien.
D’un haut degré théorique, qui n’échappe pourtant pas à la compréhension du novice – comme je le suis moi-même dans le domaine théologique -, Entre Dieu et le cosmos offre un faisceau abondant de réflexions passionnantes à propos de la nature du réel et du rapport que l’individu contemporain entretient à l’idée de divin. Il n’est ni de mon ressort ni mon but ici d’en livrer les tenants, mais je vous invite vivement à lire ce livre si de nouvelles perspectives spirituelles – au moins d’un point de vue intellectuel – vous intéressent, et que vous êtes (comme moi) lassé.e du discours new-age en circulation aujourd’hui, ou que vous cherchez à le nuancer ou l’enrichir.
Une réflexion, par exemple, que je me sens apte à vulgariser et qui m’a tout particulièrement donné à réfléchir, est celle de notre rapport au singulier et au collectif – lorsque l’on s’envisage en tant qu’âme et qu’immanence, et que l’on cherche à dépasser nos vieilles réminiscences spinozistes. La question de départ est celle-ci : qu’advient-il de notre essence après notre mort si nous sommes tout à la fois individus incarnés et matière divine ? Raimon Panikkar y répond en s’appuyant sur une métaphore « découverte dans des lectures persanes, indiennes, chrétiens, juives […] » : nous sommes des gouttes d’eau, et le long de notre vie est une trajectoire inéluctable vers l’océan. A notre mort, que se passe-t-il ? Notre goutte s’écrase dans le « pelagos infini de la mer », mais notre eau, elle, ne disparaît pas – elle se diffuse, elle s’anéantit, et tout à la fois elle persiste. Ainsi, sommes nous la goutte d’eau ou l’eau de la goutte ? Et Panikkar de nous dire qu’il nous faut dans cette vie nous réaliser comme eau et non seulement comme goutte. Il tient une réflexion similaire et tout aussi passionnante à propos de la question de l’éternité et de la nature du paradis.
Si la foi ne m’est pas parvenue (cela aurait été surprenant), cette lecture fut pour moi un vivier sans fond de réflexions exaltantes à propos de la nature du divin, de la posture d’accueil et de la vie. Je ne peux pas recommander cet essai, qui fut déterminant à beaucoup de niveaux pour moi cette année – y compris dans un registre d’appréhension et donc, forcément, d’écriture – qui me semble aussi exigeant qu’accessible.
CONCLUSION
L’année 2022 s’achève et le choix de ces recommandations fut difficile tant ils ne sont que le sommet d’une montagne de lectures aussi diverses que passionnantes. En espérant ne pas avoir ennuyé mon (inexistant) public, je vous souhaite à toustes un beau début d’année plein de mots, d’idées et de poésie – et suis toujours preneuse de nouveaux livres qui ont pu, pour une raison ou une autre – très souvent aléatoires – vous marquer comme moi au cœur, à l’esprit et au corps.
A bientôt,
Alice.
[1] A cet égard je recommande vivement l’écoute de sa chronique pour France Inter de « Mâchoires », dont elle parle bien mieux que moi.
[2] J’avais lu à l’époque un recueil composé qui comprenait des fragments en grec et en langue vernaculaire).
[3] Et, qui sait, j’espère, même peut-être un livre.
[4] Selon Wikipédia, ha, ha.
[5] Il est à noter que cela fait maintenant plusieurs années que j’essaye de me débarrasser de cette pensée idiote que tous celleux ayant écrit après les années 2000 ne méritent pas d’être lus par mes yeux innocents, comme l’attestent par exemple les deux romans que j’ai proposé en première partie de cet article – et, par ailleurs, je lis maintenant beaucoup de poésie contemporaine (entre autres pour soutenir le jeune marché de l’édition) (et j’y découvre souvent des merveilles).
[6] Mon père est traducteur, mais aussi (et a toujours été) ma référence absolue en matière de poésie, dont j’ai longtemps imaginé qu’il avait tout lu, et avec bien plus de goût que moi.
[7] Il est important ici de faire la genèse de l’œuvre et de mentionner que Douve apparaît d’abord comme personnage dans un roman surréaliste préalable d’Yves Bonnefoy, qu’il ne mènera pas à terme.
[8] Et ait même eu l’occasion d’y travailler quelques mois !
