Introduction
Chèr.e.s toutes et tous,
Ça fait un petit moment, maintenant, que je n’ai plus pris le temps de m’adresser à vous directement, ici, sur ce blog – où j’ai eu tendance, ces dernières semaines, à favoriser des formes expérimentales et à tenter (difficilement) de me soustraire aux impératifs des catégories de genre. Étrangement, prendre la parole en mon nom cet après-midi – à l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes le 11 février, il est 17h, et je remarque avec joie que le soleil est encore loin de se coucher – m’intimide un petit peu – d’autant plus que mon rapport à l’écriture est en ce moment un peu compliqué, et qu’avec la publication d’Iris et Octave vous êtes désormais nombreux à consulter ce site. Il ne m’est plus tout à fait possible de me réfugier dans l’écran de déni où je me retranchais jusqu’alors, en pensant que j’avais le droit de jeter les mots que je voulais dans l’univers, puisque le puit dans lequel je les faisais tomber était aussi obscur que déserté.
Nous sommes à la mi-février, bientôt, et c’est donc avec un bon mois de retard que je vous propose enfin cette sélection de mes lectures favorites pour l’année écoulée. Pour être tout à fait honnête, j’ai dû rédiger déjà trois brouillons de cet article, tous abandonnés très tôt dans les limbes de mon disque dur ; si vous me lisez, c’est que cet essai sera le bon, ce que je me souhaite – pour la raison au moins, vous l’aurez compris, que je suis plutôt attachée au respect des cycles, et aux traditions qui en marquent l’entrée et la sortie.
Le souci principal que j’ai rencontré, en tentant de vous présenter cette liste (qui n’a pourtant vraiment rien ni d’original ni de difficile dans l’exercice de style), c’est qu’il s’avère que mon rapport à la littérature – que ce soit dans ma position de lectrice ou d’autrice – s’est trouvé, depuis septembre, rudoyé, mis à mal, compliqué par toute une série de considérations à propos du milieu littéraire et, a fortiori, éditorial que j’ai, avec la publication, découvert et commencé à fréquenter. À la fois par pudeur mais aussi parce que je ne suis pas encore sortie de cette phase qui me contraint à repenser mon rapport aux mots, je vous épargnerai toutes ces pensées dans lesquelles je patauge, avec pour brassards et pour lestes aux chevilles un paquet d’émotions aussi troubles qu’ambigües. Certain.e.s d’entre vous s’en réjouiront donc peut-être, le quart d’heure introspectif sera plus court cette année que d’habitude.
La sélection, en revanche, sera légèrement plus longue puisque je vous présenterai aujourd’hui deux essais, deux recueils de poèmes et deux romans, ainsi qu’une courte liste jetée aux bras du vent des ouvrages de la rentrée littéraire d’automne que j’ai lu et que je vous recommande.
Allons y donc!
Simon Johannin, Ici commence un amour, éditions Allia.

De Simon Johannin, je n’avais lu jusqu’en avril que les poèmes, dont les très belles illustrations de Jacques Merle sur couverture avaient pour une bonne part contribué à mon intérêt et à l’achat qui s’en était suivi. De Nous sommes maintenant nos êtres chers et de La Dernière saison du monde, je garde un souvenir plutôt content, sans plus, si ce n’est quelques éclats poétiques qui me hantent toujours – en particulier ces vers : Pourquoi ce désir / Qu’une hache frappe violemment / De la gauche vers la droite / Et me disloque le crâne. J’ai pourtant en tête la persona littéraire, charismatique, et une idée assez nette de l’univers déployé par ses romans du fait notamment de son passage dans la section d’écriture littéraire de La Cambre, à Bruxelles. Chez Gibert, j’aperçois le volume noir et vert sur la table présentant le meilleur de la rentrée littéraire d’hiver, et j’achète Ici commence un amour, loin de me douter de l’écho que trouvera ce roman en moi.
Histoire d’une rupture, à cheval entre passé et futur, Ici commence un amour raconte les errances de Théo, un jeune romancier aussi tendre que cynique, à travers les espaces liminaires de la ville et de sa mémoire. Saisi dans l’instant de la mort, celui du départ de Gloria traversant chaque page comme un ruisseau salé, éthéré, fuyant, omniprésent, Théo engage une longue marche de réflexion et de rencontres dans les espaces qui sont les siens. Entre la banlieue sud de Paris, les défilés de mode, les petites malversations du milieu littéraire dans lesquelles il s’insère, et Marseille, ses bars à chichas, sa boboïsation rampante, sa crasse mais aussi les révélations presque mystique permises par la mer, la.e lecteur.ice est invité à rentrer dans une danse de pensées et d’émotions amenées avec un style qui relève autant de la braise que de l’eau.
Car c’est avant tout ce qui frappe à la lecture, et dès les première pages : dans Ici commence un amour, la virtuosité du style est conduite à un point incandescent. Lorsque je commence ce roman, à la terrasse des Anémones à Parmentier, je suis immédiatement soufflée par la flamboyance des phrases et l’ivresse que suscite ce point de perfection où se nichent jouissance du mot et nostalgie de leur dépôt. Alors que je rédige cette courte critique, cherchant un extrait à vous proposer, je relis ceci parmi les dizaine de pages cornées : « Sans doute ai-je trop d’orgueil, mais si écrire est un sentier de galères, qu’au prix de tant de coupures l’on a pour seule récompense cette sensation unique d’avoir su faire un feu, je sens qu’ici mes allumettes se mouillent. À chacun de mes mots envoyés vers leur monde, je sens la vitalité quitter mes membres, la magie fuir et s’effacer dans l’air de ce royaume aride. » (p.150). Hasard du doigt qui ouvre un livre, lorsque presque chaque pages recèle son lot de merveilles.
De mon souvenir de lecture, je garde en particulier la mise en abyme du roman autobiographique du narrateur, Le Misérable, qui dépeint avec une cruauté merveilleusement radicale le milieu des salons, ainsi qu’une scène splendide de réminiscences de ce que fut l’amour avec Gloria, qui conclut le cri final, douloureux, beau, sans appel :
Ma main sous ton tee-shirt qui t’attrape le sein, ma bouche qui voudrait te lécher jusqu’à le polir et qu’il brille, je tiens ferme ta nuque et t’embrasse pendant que mes doigts t’ouvrent et que tu me coules dessus. Doucement, les caresses, mes baisers dans ton cou, les doigts enserrant les doigts, les souffles et les mots glissés dans l’oreille, le jeu des muscles qui s’ouvrent et se referment et mes deux mains qui cherchent à baisser tes dessous.
La mèche s’allume quand, détachant mon corps du tien, je te sens vouloir balayer ce qui du monde existe autour, allonger les immeubles de cette ville en m’allongeant. C’est parti de la cuisine, j’ai allumé les plaques que je venais d’éteindre, l’eau est remontée du verre, le robinet fermé je n’ai plus pensé à rien d’autre, je me suis tourné vers toi, je t’ai vue.
pp. 178-179.
Et ces mots qui ont déchiré mon âme, et m’ont fait pleuré de longues heures tandis que je sortais à Alfortville du bus 24. Merveille de feux et de délicatesse. Un grand livre.
Raphaëlle Guidée, La Ville d’après : Détroit, une enquête narrative, éditions Flammarion.

Comme beaucoup j’ai été, dans mon adolescence, une amatrice d’exploration urbaine – et comme dans le paradoxe de l’œuf et de la poule, de mes balbutiements dans des hôtels abandonnés et des photos de Détroit prises par Yves Marchand et Robin Meffre dans les années 2000, je ne sais plus qui est arrivé le premier. Je me rappelle en revanche nettement du choc esthétique et des émotions qu’avaient suscité en moi ces clichés sublimes, présentant une ville aussi grandiose qu’apocalyptique et que jusqu’à ses spectres semblaient avoir fui. Les images me semblaient être l’illustration la plus juste de ce que signifiait l’expression de Birotteau, grandeur et décadence – chute exorbitée d’un capitalisme gonflé jusqu’à l’explosion, et sa dépouille grisâtre où s’entremêle cadavres d’oiseaux migrateurs et plantes rampantes. C’est ce choc initial – et les souvenirs de mes déambulations dans les manoirs hantés de mon pays – qui m’est revenu lorsqu’aux Cahiers de Colette je suis tombée sur cet essai de Raphaëlle Guidée paru dans la nouvelle collection Terra Incognita des éditions Flammarion.
Professeure de littérature comparée, l’autrice propose une exploration de Détroit, aussi appelée Motorcity, en empruntant les récits qui la traversent. Récoltant la parole de ceux qui l’habitent – habitants, universitaires, entrepreneurs, activistes – et les différents médias d’expression dont elle se vêtit – images, films, photographies, projets, archives, et mots, bien sûr, et les variations performatives qu’ils opèrent entre rêves, projets, espoirs, assertions et malédictions -, le.a lecteur.ice est petit à petit conduit dans une enquête dont la complexité s’épaissit au fil des pages. S’émancipant du récit européen commun à propos de Détroit et des moralines anticapitalistes qu’elle génère – apologue cauchemardesque d’une Motorcity dévastée, où la ville devient le cadavre devant lequel se prosternent les rêveurs d’un autre monde -, Raphaëlle Guidée amène brillamment à nous interroger sur les histoires que nous construisons à propos des lieux, et de la manière dont ceux-ci échappent nécessairement aux carcans trop étroits de nos perceptions.
Lorsque je choisis un essai, j’attends la plupart du temps qu’il vienne éclairer dans mon esprit des intuitions confuses qui sommeillaient en moi dans l’attente que quelqu’un les formule et, par-là, leur donne naissance. La Ville d’Après opère cette magie un peu plus à chaque page, tout particulièrement lorsque Raphaëlle Guidée souffle ce qu’il restait de mes évidences en abordant notre passion malsaine pour le ruinporn – pensée qu’il m’était devenu nécessaire d’explorer après avoir visité Belfast, et le triste malaise qui s’en était suivi. L’autrice explique alors que « tout en montrant la formidable puissance destructrice du capitalisme, la plupart des images de ruines tendent à assimiler ses effets dévastateurs à une tragédie inévitable, dont les causes, les processus et les chaînes de responsabilité sont trop complexes pour être modifié. […] [Or] L’enjeu de la représentation apocalyptique de la ville n’est pas seulement symbolique, il a des conséquences politiques tangibles pour les habitants de Detroit. » (p.58). Et, surtout, plus loin :
[…] On peut fuir la fin d’un monde, comme le montre le décalage entre le sort de ceux qui restent parce qu’ils n’ont pas le choix ou ne souhaitent pas quitter leur foyer et celui de ceux qui quittent la ville ou décident librement de s’y installer, pour vivre une aventure apocalyptique ou profiter des loyers bon marché. Alors que les images et les fictions postapocalyptiques racontent généralement des histoires dans lesquelles le désastre efface les différences de classe et de pouvoir, réduisant l’humain à la vulnérabilité de la vie nue, la réalité urbaine de Détroit montre que ce qui reste après l’apocalypse industrielle, ce n’est pas le faible corps mis à nu dans la tempête, comme dans Le Roi Lear […] ou l’universelle descente aux enfers, comme dans La route […] mais, encore, des inégalités : le monde est inhabitable, mais pas pour tous.
p. 79.
Et la prudence qu’induit ce raisonnement vis-à-vis des récits que nous construisons s’applique, me semble-t-il, à tous les sujets que l’on serait trop vite tenté d’isoler dans une pornographie du scandale où l’on vide, inévitablement, chaque chose de son sens. Un essai brillant, aux ramifications de pensée multiple, que je vous recommande plus que vivement.
James Noël, Le Pyromane adolescent suivi du Sang visible du vitrier, éditions Points.
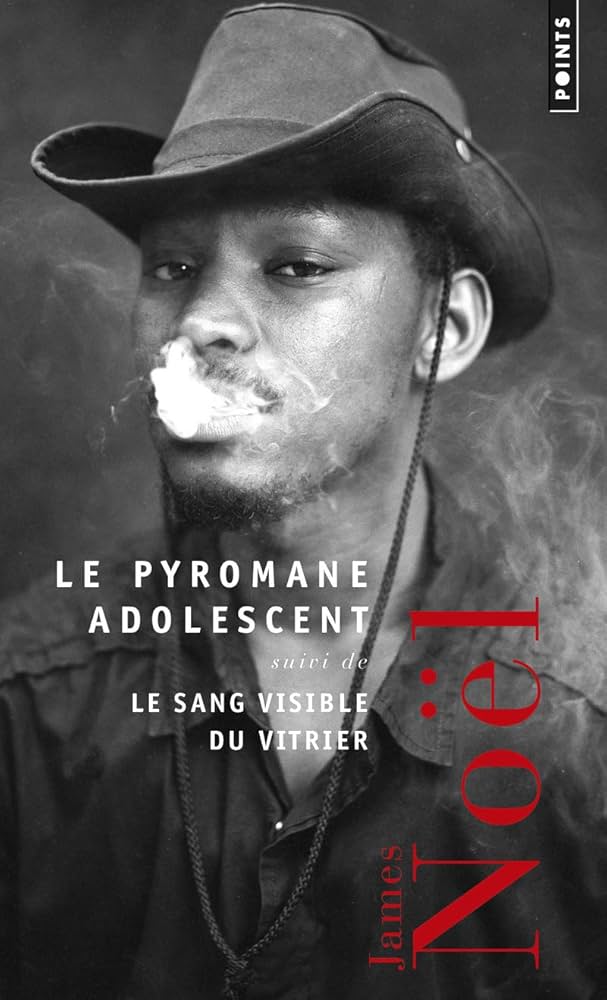
Après avoir visité l’exposition (à mon sens excellente) sur les Zombis au musée du Quai Branly, il se trouve que j’ai vécu une nouvelle intense passion transitoire pour l’histoire d’Haïti – pays que je connaissais jusqu’ici bien mal, tant dans son aspect historique que culturel, et que je ne prétend pas maîtriser mieux à ce jour d’ailleurs – et dans cette courte période de boulimie intellectuelle, la poésie haïtienne a occupé une place de choix. Parmi les auteur.ice.s (re)découvert.e.s en début d’année (Jean d’Amérique, René Depestre, Marie Vieux-Chauvet), je tombe sur un recueil de James Noël, et la première page s’ouvre et c’est une immédiate déflagration.
Né en 1978, James Noël est poète, chroniqueur, acteur, romancier, et a la plume qui virevolte comme une épée – avec violence et sensibilité. N’excellant pas dans la critique poétique, puisque je considère encore (mais peut-être est-ce une hypothèse paresseuse) que la poésie est avant tout affaire de sensation, quoique la Beauté ne relève pas pour moi de l’arbitraire, je n’essayerais pas de dénouer les tenants techniques et, si j’ose dire, informatifs de ce qui fait la splendeur de ses vers, mais me contenterais de vous la garantir.
Comme son titre l’indique, Le Pyromane adolescent est un recueil construit sur un geste primordial d’éclat, où viennent collisionner les mots et la braise – « Mes fusibles », premier mot avant de faire jaillir les étincelles entre le sang, les débris et la lame – et de cet incendie naissent inévitablement l’érotisme et la révolte, la douleur et la nuit, la jouissance et la lettre. Chaque pièce de l’ouvrage est une merveille qui appelle à sans cesse y revenir, car aucun mot ne s’y essouffle dans les cendres. J’y ai trouvé l’amour et la lune, la beauté et la colère, les larmes et le sucre particulier des fruits. J’y ai trouvé un compère, un ami, quelqu’un qui comprenait que le lieu pour moi d’où naissait la littérature était la joie et la colère, et que ces deux endroits étaient exactement les mêmes.
Précipice
les oiseaux qui se désaltèrent au crépuscule ont leur nid dans mes artères
des demoiselles
suceuses du fruit de mon grand arbre
généalogique
m’ont arraché le fémur
me voilà battu à l’aune de mes périples
je pensais au voyage des âmes sœurs
qui dans le baiser se partageaient
leurs rouges à lèvre
avant d’aller se coucher au château des fractures
« ma catastrophe a délecté tout le village »
c’est une virtuosité hémorragique qui me fait fleuve
qui fait menstrues pour réinventer les règles
des filles de joie et des tristes filles
des amants sans coeur
pour la permutation des battements
qui font palpiter les montres
aveugle-née calcinée
l’ombre dans le brasier qui l’apprivoise
nul baiser liquide
dans la fusion des corps chimique
ne résulte de l’amour précipité
un nuage avance
la lune est borgne
un oiseau de mes artères
brûle sa cervelle
aux pailles du crépuscule
Merveilleux au point que l’on s’abstiendra de le commenter.
Milan Kundera, L’Immortalité, éditions de la Pléiade.
Ce n’est un secret pour personne, je nourris une passion dévorante, presque enfantine et proche de la dévotion pour l’œuvre de Milan Kundera, que je relis régulièrement et en particulier lorsque je nourris le projet d’écrire et que je peine à donner à mes histoires le sens et le ton qu’il leur faut. Ainsi, cet été, alors que j’étais partie opérer une « retraite littéraire » (ainsi mise entre parenthèses car elle fut un semi-échec, gangrenée par la pluie, des champs de maïs à perte de vue et une indécrottable mauvaise humeur) à Colares, au Portugal, j’ai eu la bonne idée de me replonger dans L’Immortalité qui est à mon sens l’un – si ce n’est le plus grand – des meilleurs romans de Kundera.
Publié en 1990, et dernier roman écrit en tchèque, L’Immortalité raconte l’histoire de deux sœurs, Agnès et Laura, à partir du geste unique de la première sur les carrelages mouillés d’une piscine municipale parisienne. Amenant la réflexion autour de laquelle se construit le roman, une pensée qui naît dans la tête d’Agnès lorsqu’elle s’interroge sur l’amour qu’elle ressent pour son mari : si un alien lui donnait la possibilité d’être immortelle, voudrait elle passer la nuit des temps à ses côtés ? – et le malaise qui s’ensuit, car elle sait bien que non, et que Paul, son époux paradoxal, partage certainement cet avis, mais que ni l’un ni l’autre n’oserait formuler ce refus dans le monde matériel, sous peine de tuer leur amour, et qu’il s’en suivrait une condamnation à être coincés l’un avec l’autre pour l’éternité.
S’interrogeant sur le hiatus temporel existant entre le soi et l’image que l’on se fait de soi, entre mortalité et éternité, Kundera explore à travers une banale histoire de vie conjugale, où l’on couche sans le vouloir et où l’on se trompe avec autant de nécessité que de regrets, la thématique de la mort et de l’image. Enrichissant son propos, comme à son habitude, de réflexions chagrines et drôles (faut-il rappeler que l’auteur déplorait souvent que l’on n’aborde pas son œuvre avec un regard comique !), on croisera Goethe et l’ambitieuse et pathétique Bettina, un Rubens des temps modernes qui fait l’amour athlétiquement, un professeur à cheval entre le livre et le réel qui organise des partouzes avec des mannequins de vitrine et prend des bains de vapeur, ainsi que l’auteur lui-même, contemplant son roman en train de se faire.
J’avoue avoir un faible persistant pour les incursions de l’auteur dans la narration[2], et en profite pour vous partager rapidement ma préférée de l’année, dans Stella et l’Amérique de Joseph Incardona (que j’ai hésité à inclure dans cette liste tant j’ai adoré sa prose, proche de l’un de mes auteurs favoris au monde, Edgar Hilsenrath) où, de façon complètement impromptue, entre deux lignes, il écrit : « […] ici même les tueurs ont leur dignité, on les aime un peu, forcément, quand même, parce qu’ils sont des rouages de l’épopée, ils sont la légende, ce que je tente de décrire. Et j’ai trop bu, et je suis si triste, faut pas m’en vouloir de ce lyrisme, je reviens, j’en reviens à mes personnages, ils sont mon rêve à moi – j’en reviens, […] ». Bref, dans L’Immortalité, on est servi – et chaque réflexion s’étire et s’épanouit avec une intelligence dont la subtilité me semble chaque fois inégalable. Les pages, en particulier, qui narrent l’affaire de Bertrand Bertrand, promu âne intégral, ainsi que celles où Kundera s’attaquent aux éperons que nous élisons récifs de notre personnalité – jusqu’à ce qu’ils s’érodent lorsque les autres s’en saisissent – me semblent d’une justesse brillante, élégante, rare.
Relire Kundera est un plaisir chaque fois renouvelé, que je défendrais jusqu’à ma mort sans doute, et dont je ne me lasse pas malgré mes inévitables discours à ce sujet lorsqu’il m’a fallu assumer cette filiation dans le cadre de la parution d’Iris et Octave.
Nicolas Framont, Parasites, éditions Les Liens qui libèrent.
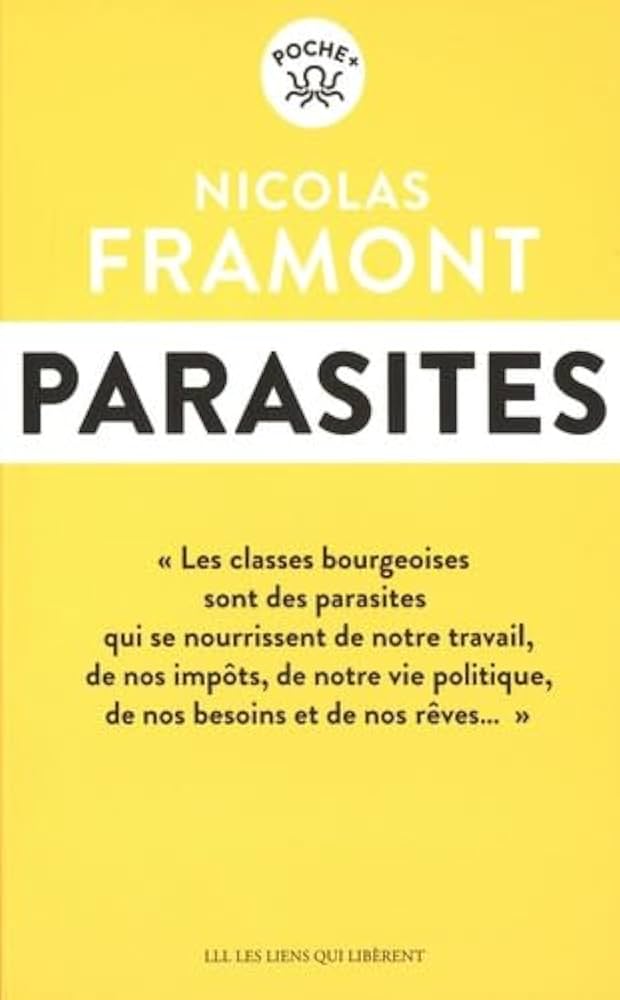
Dans un tout autre registre (courage, courage, cette liste arrive bientôt à son bout – en ce qui me concerne, nous sommes désormais le 13 février, et j’ai décidé que c’était bien ce soir que j’allais en finir avec cet article, que je prends pourtant de plus en plus de plaisir à rédiger : comme quoi, l’écriture est proche de la mécanique et du muscle, qu’il s’agit d’huiler sans cesse), j’ai eu le bonheur de découvrir au début de l’année dernière Nicolas Framont par l’intermédiaire de son essai Parasites. Trouvé à la librairie Les Caractères (Paris 13), le petit volume jaune attire mon regard par la radicalité de son titre, dont il ne faut pas attendre longtemps pour comprendre ce qu’il désigne, à savoir la bourgeoisie.
Le postulat initial du livre est violent mais simple (et à mon sens exact, en priant pour que cet article tombe entre de bonnes mains et ne m’attire pas trop d’ennemis) : ce qui mène notre monde à sa perte, notre adversaire[3], ce n’est pas « le monde de la finance », ou autre écran de fumée nébuleux constitué de matière noire, de lois physiques abstraites et de matière cosmique, ce sont des gens – certes au service du capitalisme -, et ces gens nous pouvons et devons les nommer. Commençant par dénoncer les bons élèves qui « […] face à une actualité ou dans une conversation, vont trouver le moyen de défendre une société injuste en la faisant passer pour bonne et nécessaire […] [et qui] éprouvent un besoin vital de justifier une situation dont ils sont la plupart du temps bénéficiaire » (p.18, et ce propos m’attaque très directement aussi, à beaucoup d’égards), Nicolas Framont rappelle que « être en colère face aux injustices est fatigant : parfois, il est plus reposant de se raconter que les choses se sont ainsi pour une bonne raison » (p.21).
Alors, il fera le travail à notre place, en démontant une à une les fables que l’on se raconte pour tolérer la douleur d’un réel qui contredit en permanence les utopies néolibérales. Ainsi du ruissellement des richesses, qui non seulement ne ruissellent pas, mais sert de miroir aux alouettes pour masquer licenciements massifs, robotisation, évasion fiscale. Ainsi de la libre concurrence et de la libéralisation monétaire. Ainsi de notre espoir aussi naïf que compréhensible que ces gens ne savent pas ce qu’ils font, qu’ils y croient, que la classe bourgeoise ne mentirait pas délibérément et avec un tel cynisme. Nicolas Framont martèle, cite, démonte, fracasse. Il donne les noms, épluche les épopées flamboyantes des entrepreneurs en couverture de Forbes ou du Times, rappelle le prénom de leur père, dépoussière leurs casseroles. Personne n’échappe à l’amer constat des exactions commises par la classe bourgeoise – médias, patrons, politiques, actionnaires. On décortique les conséquences idéologiques, écologiques, politiques et sociales de leurs actions. En conclusion, à la question « Mais pourquoi sont-ils si méchants ? », Nicolas Framont explique : « Je crois que cette question trahit notre faiblesse. En beaucoup d’entre nous réside l’espoir, typique de celles et ceux qui ont subi des décennies de domination, que nos maîtres conservent au fond d’eux une certaine empathie pour nous autres, et qu’ils sauront s’en rappeler le moment venu. » (p.275).
Un essai engagé, sans concession, qui conduit inévitablement à se demander comment organiser la révolte. À défaut de partager ses vues, Parasites est une lecture hygiénique pour chacun et chacune d’entre nous, lorsqu’il s’agira d’assumer nos choix politiques et éthiques en pleine conscience de ce dans quoi nous baignons.
Yannis Ritsos, Le Mur dans le miroir et autres poèmes, éditions Gallimard.
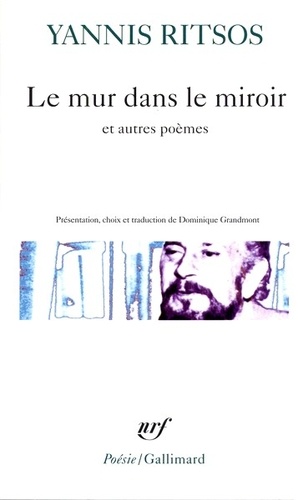
Alors que l’année précédente avait été, en termes de découvertes poétiques, assez pauvre, impossible de conclure cet article sans mentionner mon ultime coup de cœur de 2024 (si j’avais eu plus de place, et que je savais maîtriser mon rapport aux digressions, je vous aurais également parlé de Léon Gontran-Damas et de Black Label, pure merveille), à savoir Yannis Ritsos et plus particulièrement du Chef d’œuvre sans queue ni tête (ou Chef d’œuvre monstrueux dans l’édition que j’ai offerte à mon père à Noël, parue en 2017 chez Ypsilon).
Né en 1909 à Monemvasia et mort en 1981 à Athènes, Yannis Ritsos est un poète grec, fils de propriétaires terriens vite confronté à la maladie, à la mort, et à la dépossession, et militant communiste qui connaîtra, du fait de son engagement, l’enfermement dans les camps de rééducation lors de la guerre civile qui, après la 2nde Guerre Mondiale, déchire la Grèce. Portant une œuvre foisonnante, aux ramifications multiples, entre considérations politiques, réécriture mythologique dans la veine de Cavafis, et surréalisme, l’écriture de Ritsos porte en elle un battement et un souffle maritime, bagarreur, virevoltant, révolté. Adoptant un langage familier, inscrivant son rythme dans la rupture, la logorrhée et l’enchevêtrement, la poésie de l’auteur respire la joie et le futur, l’amitié et la fureur.
C’est, en particulier, le Chef-d’œuvre sans queue ni tête, qui se présente comme une longue pièce autobiographique, les « Mémoires d’un homme bien tranquille et qui ne voulait rien savoir » qui m’ont ébloui par la singularité de leur écriture, enfilant des parataxes à la beauté sublime et où la colère et la jouissance[4] roulent les unes sur les autres avec une dextérité folle qui n’en amoindrit pas les sentiments de paix et se mélancolie. Acte de foi au sein duquel le Je vient se bousculer au monde, aux histoires qui s’y racontent, aux utopies politiques et aux petits cafés noirs bus sur des comptoirs d’acajou, le.a lecteur.ice est embarqué dans une danse burlesque, où l’on parle de politique dans la fumée et le tressautement des nerfs.
[…]
j’ai vieilli d’une jeunesse sans fin qui n’arrive pas à vieillir
chaque jour il y a davantage de femmes qui m’aiment avec leurs yeux bleus très agrandis au crayon noir
& des garçons aux cheveux longs & aux mâchoires toutes crisstantes
je ne sais comment faire entrer cela dans mes veines & dans les mots
la Révolution m’entraîne bras dessus bras dessous nous sortons tous les deux faire un tour sur les boulevards illuminés
tard dans la nuit deux heures après la poésie tandis que veillent encore infatigable les communistes en train d’étudier Lénine
j’essaie de ne pas déchoir d’un millimètre au-dessous de ma propre joie
[…]
p. 273.
Impossible de s’arrêter quant à la fois je ne cesse de rouvrir mon volume NRF Gallimard, acheté chez Gibert et dont les feuillets s’échappent un peu plus à chaque lecture. C’est pour le style, surtout, que j’ai aimé découvrir Ritsos et l’impact que cette folle libération esthétique a eu – a – encore sur moi. Je suis loin, pourtant, d’avoir épuisé mon cheminement dans les branches de cette œuvre titanesque, et vous en redirai donc peut-être des nouvelles à l’occasion. Lisez Ritsos, révoltez-vous, et surtout – ne déchoyez pas d’un millimètre en-dessous de votre propre joie.
Conclusion
Alors que je traverse une période de sécheresse dans mes lectures (c’est sans doute le moment de confesser que quand cela m’arrive, pour remettre la machine en route, je me jette sur un roman policier choisi au hasard sur les tables de présentation de chez Gibert), écrire cet article m’a procuré un plaisir fou, car je réalise chaque fois combien les mots des autres m’inspirent, me guident, et m’aident – tout lyrisme difforme mis de côté – à mieux respirer le monde qui m’entoure.
Au dernier semestre 2024, par l’entremise des salons et autres évènements littéraires auxquels, pour la première fois de ma vie, j’ai été conviée en qualité d’invité (et, honnêtement, je me remet à peine d’avoir été de l’autre côté de la table, et du bonheur de gamine que j’ai ressenti lorsque j’ai bu une bière en terrasse d’un bar bisontin avec Bernard Minier, que ma marraine adorait, et dont j’ai lu l’intégralité de la saga Servaz à la suite de son décès), j’ai rencontré toute une foule de romanciers et de romancières débordant de talent. Je suppose qu’à ce stade de mon récit, peu d’entre vous auront eu la foi de me lire jusqu’au bout, et je peux donc avouer avec toute la pudeur qui convient que cette entrée dans le monde littéraire, aux côtés de gens que j’ai considéré et considère toujours comme des quasi-dieux, puisqu’ils avaient réussi à écrire (!!!), a généré en moi beaucoup d’inquiétudes ; et que ce que je tire de plus beau dans cette aventure fut d’avoir découvert qu’au-delà du talent, tous ces gens côtoyés étaient également gentils, singuliers, sympathiques, passionnants.
Je me suis fait des copains et des copines, ait acheté des livres par dizaine, ai beaucoup trop bu, beaucoup découvert, beaucoup rencontré, beaucoup vécu ; il m’est difficile, donc, de vous partager parmi ces ouvrages de la rentrée d’automne ceux qui m’ont le plus plu, mais je voudrais mentionner quelques romans malgré tout. Les Caractériels de Martial Cavatz, pour la précision de son style et de son propos, cruel, drôlatique, extrêmement juste et bien écrit ; Le Gars qui allait quelque part de Michel Bezbakh, un monologue que l’on ne peut quitter avant son terme, à la prose et à l’humour enfiévrés ; Le Retour de Saturne de Daphné Tamage, pour son atmosphère mystique et désabusée, et la tristesse et le rire qui parcourent cette exploration d’une mémoire amoureuse ; Les Grandes patries étranges de Guillaume Sire, car c’est peut-être l’un des livres que j’aie lu où l’on ressente si fort l’amour que l’auteur porte pour les mots et, par extension, pour les choses.
À l’année prochaine avec, sans doute, d’autres émotions mais toujours, je l’espère, de si jolies découvertes,
Alice.
[1] Pour être précise, ce poème appartient au Sang visible du vitrier, qui est accolé au Pyromane adolescent.
[2] Que mes étudiants en lettre se rassurent, il va de soi que j’opère la distinction auteur/narrateur/persona narrative
[3] Pour reprendre les propos de François Hollande
[4] Sensations poétiques qui m’obsèdent en ce moment, vous l’aurez compris.
