Temps de lecture : 15 minutes

Introduction : naviguer entre monomanies et obsessions
Un an après mon premier vrai article de blog, me voici de retour – non sans fracas -, pour un nouveau billet proposant une mise en lumière de mes cinq plus belles lectures en 2023. Cinq, à vrai dire, est un chiffre parfaitement arbitraire (auquel je risque d’ailleurs de ne pas me tenir car je compte confesser une étrange obsession transitoire à la fin de cet article) et c’est sur cette transition parfaite que je vais me livrer sans scrupules à mon exercice préféré : déballer des petits lambeaux de mes heures d’introspection quotidienne. En janvier 2023, je vous expliquais adorer dresser des listes et des bilans (bien entendu, ça n’a absolument pas changé, et j’ai d’ailleurs inauguré il y a trois jours à peine le nouveau carnet que je dédie à cet effet) ; en janvier 2024, il est temps pour moi de mentionner que parmi les diverses expressions de mon locus de contrôle, il y a cette passion pour les structures rigides et les habitudes quotidiennes.
Si, par exemple, un jour au hasard, je me rend dans un bar proche d’un cinéma auquel je vais souvent, c’est dans ce même bar que je retournerai systématiquement toutes les prochaines fois où je me rendrais au dit cinéma – il peut être le plus cher du quartier, voire même désagréable, c’est désormais mon bar et je m’y sens presque un devoir de fidélité. C’est donc par ce même processus mental (que je ne vais pas m’embêter à détailler plus en détail car, après tout, on n’est pas là pour ça), que je conserve une liste de cinq ouvrages, pas plus, pas moins, et j’en ferai probablement de même l’année prochaine et pour toutes les années à venir.
Sautons donc gaiment dans le cœur de notre sujet.
Parmi les cinq livres sélectionnés cette année, nous avons deux romans, un recueil de poésie, un journal intime et un essai. On constatera que les mois passent et n’y changent rien : en 2023, j’ai approfondi ma toute théorique (et toute charnelle à la fois) passion pour la théologie – catholique en particulier -, continué à tourner en rond autour de l’Irlande (et qui sait, peut-être avancé sur ce que ça voulait dire pour moi, et la manière dont je souhaite à l’avenir en parler), lu beaucoup de femmes, ce dont je suis heureuse, et ai avancé comme à mon habitude par longs à-coups intenses de périodes hyperfixatives à propos de tel ou tel sujet – typiquement, en août, après avoir été voir l’adaptation de la bande dessinée Les Algues vertes au cinéma (adaptation d’un reportage d’Inès Léraud par Pierre Jolivet), j’ai vécu deux semaines d’intérêt intense pour l’histoire de l’agriculture en France, de l’industrie agroalimentaire et l’état actuel de nos connaissances en nutrition[1] – j’ai presque envisagé un retour sur les bancs de la fac en STAPS ou en géographie, avant de me désintéresser du sujet aussi vite que la passion était venue[2].
Phase étant donc officiellement devenu le mot-clé de tout l’article à venir, commençons.
Beaux et Damnés, F.S. Fitzgerald

Aux alentours de mes vingt ans, j’ai vécu une période de grande passion littéraire pour les auteurs américains du vingtième siècle. Pour la Beat Generation, d’abord, qui a nourri une bonne partie de mon imaginaire romantique adolescent, peuplant ses images de vagabonds qui font l’amour sur les bords de route et dansent le jazz dans des motels désaffectés ; pour la Lost Generation, ensuite – nom donné en temps réel par Gertrude Stein pour baptiser ce groupe d’écrivains (et artistes en général) américains venus s’installer à Paris durant l’entre-deux guerre. C’est dans ce contexte d’intérêt un peu fouillis pour tout ce qui avait trait à l’Amérique en général que j’ai enchaîné une longue période de lectures des auteurs classiques américains[3] et, plus spécifiquement, des novellistes. Parmi ceux-ci, « Dressez haut la poutre maîtresse, charpentiers » et « Franny et Zooey » de Salinger ainsi que le minimalisme de Raymond Carver – dans « Tais-toi, je t’en prie », par exemple – avaient en particulier retenus mon attention. Mais la grande découverte de l’époque avait été « Un diamant gros comme le Ritz » de Fitzgerald, dont j’avais lu l’incontournable Gatsby des années plus tôt.
Cet intérêt particulier pour F.S Fitzgerald s’est confirmé avec « Tendre est la nuit » (1934), dont la lecture, quelques années plus tard, m’avait bouleversée – d’autant qu’elle s’était enrichie d’un travail de mise en perspective du roman avec les propres écrits de Zelda, une polémique existant quant au caractère de plagiat du roman, Fitzgerald ayant pioché dans les écrits personnels et intimes de sa femme pour écrire le récit à peine voilé de sa chute[4]. En dépit de mes convictions et, forcément, du malaise ressenti à la lecture d’une œuvre soulevant de tels problèmes de violences sexistes et d’invisibilisation des femmes, « Tendre est la nuit » avait été une révélation stylistique. Cette impression de maîtrise narrative poussée à son apogée m’était restée très vive jusqu’à ce que, un après-midi de mars, alors que je flânais chez Gibert en quête d’un nouveau livre, je me suis rappelée que lire Fitzgerald était toujours une bonne idée. C’est tout naturellement, donc, que j’ai choisi un de ses romans les plus connus : « Les Heureux et les Damnés »[5].
Publié en 1922 et non moins inspiré de sa relation tourmentée avec Zelda, « Les Heureux et les Damnés » raconte l’histoire d’un couple et de sa déchéance à venir. Situé aux débuts de l’ère du jazz, c’est lors d’une soirée mondaine qu’Anthony Patch, aspirant écrivain et héritier d’un richissime baron de l’industrie, rencontre l’imprévisible et insouciante Gloria Gilbert. Si la première partie du roman s’occupe à nous raconter les tourments de cet amour naissant et la cour semée d’embuche que mènera ce jeune homme ayant avant tout la richesse avec lui, « Les Heureux et les Damnés » trouvera son sens et son propos dans ce qui viendra par la suite – une fois l’union accomplie et consommée.
Car Anthony et Gloria, dont la richesse les préservait autrefois de toute inquiétude quant à la fragilité de ce qu’ils croyaient acquis, c’est-à-dire l’amour et la richesse, verront une fois mariés leurs espérances se heurter avec violence à la réalité du temps – et la révélation portée par le temps est celle de la précarité des positions, de l’hypocrisie de la vie et des autres, et de l’enlisement de l’amour et des rêves dans les marécages de l’ennui. Ainsi, petit à petit, l’argent vient à manquer, et la vie soudain semble moins belle : on ne peut plus accéder aux clubs, les amis se raréfient, la vie semble plus terne et plus ténue, et même la flamboyante Gloria semble perdre l’étincelle que son arrogance avait déguisé en énergie vitale éblouissante.
Tout le long du roman, c’est un lent déclin qui nous est présenté, espérances et idéaux pourrissant inexorablement au contact du réel et de ses déceptions – thème qui m’est cher, vous le savez peut-être. La déchéance, dans « Les Heureux et les Damnés », s’inscrira ainsi à tous niveaux – et c’est ce qui fait selon moi l’intérêt du roman – : sur le plan social, d’abord, où l’on nous présente le déclassement progressif d’un couple d’aristocrates dans un milieu mondain où l’amitié ne résiste pas à l’absence, et où la présence est soumise aux capitaux que l’on peut poser sur la table ; sur le plan amoureux, ensuite, où l’on ne sait plus bien qui détester, d’une Gloria dont la sympathie et l’imprévisibilité se transforment soudain en façade de coqueluche ou d’un Anthony dont l’intelligence et le talent croupissent dans la paresse et la médiocrité ; et sur le plan personnel, ensuite, Gloria se faisant rattraper par la maladie mentale et Anthony par un alcoolisme nourri par le désespoir et le déni.
Les derniers chapitres, en particulier, sont d’une violence crue. J’ai terminé « Les Heureux et les Damnés » un dimanche de mai, sur les berges de l’Oise où j’étais partie faire une randonnée[6] et me rappelle avoir refermé le roman avec douleur tant mon empathie pour Anthony Patch, lors des dernières scènes, était élevée. J’ai continué à marcher le long des berges et dans le village d’Auvers avec des nœuds d’angoisses dans le corps à trop voir le comptoir du Sammy’s sous mes yeux, plutôt que le vent frais.
Ainsi, et comme pour les précédents ouvrages de l’auteur que j’ai pu découvrir, c’est encore un coup de maître que réalise Fitzgerald avec un roman à la narration parfaitement élaborée, oscillant entre sublime et pathétique sans jamais voler trop haut de la réalité et sans jamais rien abandonner au plaisir de lire. En tant qu’écrivaine, je le situe très haut dans mes sources d’inspiration et mes modèles pour ces raisons précises. Pour toutes ces raisons, je recommande plus que chaudement ce classique de la littérature américaine de la Lost Generation, dont le récit poignant ne pourra vous laisser indifférent.e.s.
Journal d’Irlande, Benoîte Groult

Ca ne sera une surprise pour personne, j’adore les journaux intimes. Tenant le mien depuis que je suis en âge d’écrire à peu près, et m’étant mise à mon activité de diariste avec sérieux aux alentours de mes vingt ans, je suis depuis des années une lectrice assidue du Journal d’Anaïs Nin, auquel je reviens régulièrement, et me suis toujours plu – lorsque c’était possible – à compléter mes découvertes d’auteur.ice.s par la lecture de leurs journaux – ainsi, par exemple, les Carnets de Cioran, que j’aime au même titre sinon plus que ses aphorismes, les journaux du philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel, les incontournables Notes de chevet de Sei Shônagon, les lettres de Neal Cassady ou Les Mémoires de Saint-Simon (un chef-d’œuvre d’aigreur et de misanthropie que je recommande chaudement).
C’est peu dire, donc, que quand je suis tombée sur le volume du « Journal d’Irlande – Carnets de Pêche et d’amour 1977-2003 » de Benoîte Groult le livre partait déjà avec dix pas d’avance pour finir parmi mes lectures préférées de l’année (voire toutes années confondues). Et, en effet, cet ouvrage composite a été pour moi une révélation merveilleuse, au-delà de ce que je pensais qu’elle pourrait m’apporter.
Autrice, journaliste et militante féministe majeure de la seconde moitié du vingtième siècle, Benoîte Groult est une écrivaine et penseuse dont l’œuvre, je l’avoue, m’avait à peu près échappé jusqu’alors[7]. Son journal irlandais m’a dès lors servi de porte d’entrée à son univers foisonnant d’intelligence, d’humour, d’amour et de férocité. Personnalité singulière, souvent mordante et exigeante mais aussi prompte à se remettre en question – notamment en ce qui concerne ses positionnements politiques, qui ont avec les années énormément évolué – et à l’avant-garde sur un certain nombre de question politiques – elle aura, par exemple, été l’une des premières à lutter ouvertement pour la féminisation des noms de métier à une époque où ça n’allait pas de soi[8], Benoîte Groult est une écrivaine à l’œuvre prolifique et diversifiée.
Diariste assidue – j’apprendrai plus tard dans « La Mère morte » de Blandine de Caunes, sa fille, que dans la famille Groult-De Caunes, la rédaction et la lecture publique du journal intime est une tradition familiale à laquelle on ne peut se soustraire[9] -, le « Journal d’Irlande » est un ouvrage composite post-mortem[10] faisant s’entrecroiser, selon le projet de l’autrice, les carnets de pêche tenus en Irlande durant plus de vingt été par Benoîte et son mari, Paul Guimard, et ses journaux intimes de l’époque.
Le livre devient dès lors un journal dont « l’intrigue » se situe dans la péninsule de Beara[11], où l’on suit le couple de Benoîte et Paul sur vingt-six ans, de leurs premiers séjours dont l’objet était de trouver la maison idéale pour s’aimer, au récit de la vie locale en passant par la passion de la pêche et la passion, surtout, de Benoîte pour Kurt, son amant américain retrouvé sur le tard. D’années en années, c’est la question de la vieillesse qui se dessine, sous un angle positif d’abord : celle d’un renouveau amoureux et érotique, l’autrice renouant avec Kurt alors qu’elle est âgée, déjà, de cinquante-sept ans ; sous un angle négatif, ensuite, les années passant et l’inéluctable vieillesse des corps et des esprits gagnant peu à peu les protagonistes de ce triangle amoureux aussi simple que difficile.
Ce qui fait tout le charme et toute la saveur de ce journal, au-delà du style délicieusement maitrisé et piquant de Benoîte Groult, ce sont bien toutes les problématiques cruciales qu’il traverse, avec autant d’humour que leur sujet est grave ou important. Ainsi l’Irlande et ses charmes, bien sûr, mais aussi et surtout la sexualité des personnages âgées, qui m’est pour la première fois présentée comme heureuse, épanouie, excitante et légère – un non-sujet, en somme -, mais aussi l’approche de la mort et le bruit de ses sabots et, bien entendu, le féminisme avec ce que cet angle de vue révèle des problématiques d’une union conjugale hétérosexuelle.
« 7 août – Paul bizarre au déjeuner : il avait beaucoup bu et il répétait des paradoxes et des contre-vérités. Finalement, il nous a demandé, à Nicole et moi, de lui rapporter de Waterville où nous allions faire les courses « des légumes amusants » […] Et il est parti dormir. Et quand il ne dort pas, il me suit partout comme un enfant de cinq ans. Touchant, mais pesant. Pourquoi a-t-il, ont-ils, tant besoin de moi qui ai si peu […] besoin des autres ? Moi qui me sens si solide, et eux si dépendants, leur bonheur suspendu à mon adhésion. J’ai l’impression d’être un nageur auquel deux gros corps lourds et fatigués se pendent et que je traîne. » (p.193)
« Suis au lit avec mon grand Kurt et ses secousses spasmodiques qui agitent son sommeil. Il se défonce et voudrait mourir en faisant l’amour. On s’y emploie, mais il ne meurt pas du tout. « Hélas ! » dit-il. Et moi, je suis en vie et fais le plein de vit. […] Je vois venir l’échéance dans une paix étrange. Un affreux sentiment de salope, sans doute. » (p. 127)
Et cette phrase aussi courte qu’assassine, dont je ne suis pas parvenue à retrouver le numéro de page : « Paul est mort un jour sur deux : il s’entraîne. »
Pour son style savoureux, l’esprit avec lequel il aborde certains sujets si essentiels et les paysages qu’il traverse, le Journal d’Irlande de Benoîte Groult a été de loin ma plus belle lecture de l’année. Ça fait du bien autant que ça émeut : je ne saurais que chaudement la recommander.
Une certaine inquiétude, François Bégaudeau et Sean Rose
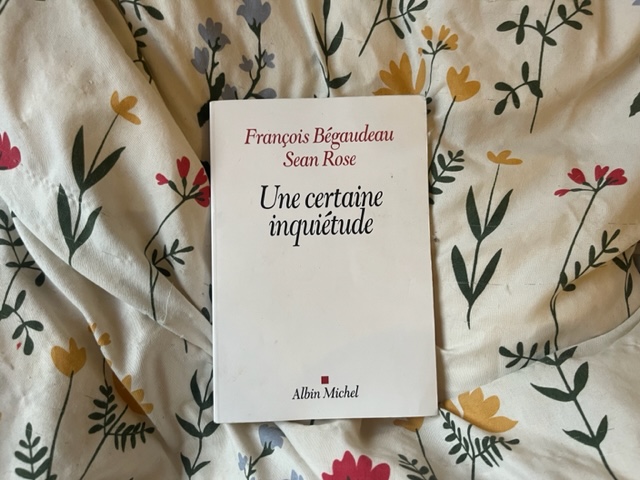
2023 a encore une fois été une année riche en lectures théologiques/ tournant autour de l’étude des religions, et 2024 le sera certainement encore tant ce champ d’études ou cet univers d’images et de pensées me parle et m’inspire. En cela, faire un choix parmi les ouvrages de cette catégorie qui m’ont le plus marqué s’est avéré difficile, des incontournables (relus pour certains, tels que le splendide « La Pesanteur et la grâce » de Simone Weil ou le plus hermétique « Livre des œuvres divines » d’Hildegard von Bingen) aux essais les plus instructifs (je vous conseille ardemment « Des femmes et des dieux » de Kahina Bahloul, Florianne Chinsky et Emmanuelle Seyboldt, qui est simple à lire et brasse un ensemble de sujets relevant de la théologie, de l’histoire des religions et de la place des femmes dans les religions du livre très pertinent avec un angle de vue pluriel) en passant par des romans-ovnis tels que le « Sermon de Saint-Thomas d’Aquin aux enfants et aux robots », de Sébastien Lapaque. Finalement, c’est de l’ouvrage croisé de F. Bégaudeau et S. Rose, sous-titré : « Un athée qui croit un peu et un croyant qui doute beaucoup », que je choisis de vous parler aujourd’hui, pour les raisons suivantes.
Coécrit entre 2016 et 2017, l’essai se distingue d’abord par sa forme, relativement rare de nos jours, puisqu’il s’agit bel et bien d’une correspondance – échangée par mails, l’époque le veut, mais un dialogue tout de même, construisant sa réflexion de camp à camp, petit à petit, au gré des interrogations et des certitudes de chacun. Nous avons donc d’une part Sean Rose, journaliste littéraire et critique d’art franco-vietnamien, élevé dans la foi anglicane et chrétien pratiquant ; et, de l’autre, François Bégaudeau, écrivain, scénariste et chanteur français connu dans le champ contemporain pour son engagement politique marqué à l’extrême-gauche – proche du marxisme libertaire. C’est en écoutant un épisode du podcast « Lumière Intérieure » dans lequel il intervenait[12] que j’ai pris connaissance à la fois de l’intérêt de Bégaudeau pour le catholicisme et de l’existence de ce livre, ce dont je ne serai jamais assez reconnaissante.
De la même façon que pour l’essai de Raimon Panikkar que je vous avait présenté l’année dernière, je ne suis pas tout à fait à l’aise avec l’idée de vous présenter ici un condensé d’apprentissages religieux, à plus fortes raison que « Une certaine inquiétude » se présente sous la forme d’un dialogue et donc de pistes de réflexions plutôt que d’assertions, provenant d’écrivains et non de philosophes ou de théologiens. A cet égard, je souligne qu’un des aspects agréables du livre tient aussi à la complexité des personnalités qui émergent à travers l’échange et à l’exploration de leurs affects, vices et insécurités réciproques. Contentons nous donc de souligner la richesse des thèmes brassés, l’élégance des doutes, des espoirs et des ambivalences et le foisonnement des images et des idées.
Mon exemplaire de « Une certaine inquiétude » est complètement détruit par les ratures, les soulignages, les points d’exclamations hargneusement tracés dans les marges à chaque passage qui m’intéressait, me parlait ou m’interrogeait – c’est-à-dire à peu près à chaque pages, ce qui en dit long sur l’heureuse rencontre qui peu parfois exister entre un individu et un livre. C’est, bien sûr, les prises de stylo de Bégaudeau qui m’ont parlé le plus intimement, car son parcours est celui qui ressemble le plus au mien : celui d’un adolescent gorgé de philosophie et de littérature, issu d’un milieu bourgeois et principalement athée, et qui affiche dans ses premières années d’étude une condescendance peinturlurée de superbe pour les religions et leurs fidèles. Puis vient l’ombre d’un doute – celui qui arrive à petits pas feutrés lorsqu’on s’aperçoit qu’une bonne partie de nos références et des écrivain.e.s que l’on admire le plus – Pascal, Pasolini, Bernanos, Péguy, Scorsese, Simone Weil – se sont affiliés avec force à leur foi chrétienne. Bégaudeau résume le trouble en ces termes : « […] un raisonnement rudimentaire s’impose à moi : ces types sont des monstres d’intelligence et ils sont chrétiens, c’est donc que le christianisme n’est pas si con »[13].
Attrait et intérêt de la figure du Christ, état de l’église, importance du rituel, idée de la foi comme d’un rapport de confiance, vitalisme nietzschéen, condescendance vis-à-vis des fidèles, place de la performance et de l’hypocrisie, nudité de la chair : « Une certaine inquiétude » est un essai si riche et si accessible à la fois que je conseille à tous les rêveurs métaphysiques de se le procurer au plus vite – impossible de ne pas, dans le lit de son fleuve, voir sa réflexion sur la foi – sa fragilité, la sienne et celle des autres – s’enrichir et grandir.
Avec toutes mes sympathies, Olivia de Lamberterie

J’ai hésité quelque temps avant de me plonger dans la lecture de « Avec toutes mes sympathies » car je savais que les thèmes qu’il brasse et aborde seraient sans doute difficiles pour moi – mais pour qui ne le sont-ils pas ? Olivia de Lamberterie, née en 1966, est une journaliste et critique littéraire française. Chroniqueuse entre autres au Masque et la Plume, que mon père et ma belle-mère écoutent religieusement chaque semaine – ce qui suffit pour moi à l’élever au panthéon des personnalités qu’on admire craintivement -, elle prend la plume pour la première fois pour honorer une promesse et exorciser la douleur : raconter le deuil de son frère, Alexandre, qui s’est donné la mort à Montréal le 14 octobre 2015.
« […] Je vais m’y coller, pour toi, pour moi, Des années que je tourne autour , que j’avale des bibliothèques pour repousser l’échéance. Encore un roman à lire, monsieur le bourreau. Les mauvais écrivains me volent ma vie. Nous avions parlé de cette envie d’écrire, mêlée à la peur de se jeter dans le vide, de passer de l’autre côté, la dernière fois que je t’ai vu. Quand était-ce, je l’ignore, comment aurais-je pu imaginer que nous vivions notre heure ultime, dans la même pièce, dans le même sanglot ? Tu disais qu’il n’y avait plus d’espoir. C’était à Montréal, fin juillet, tu étais chez les dingos. Et tu m’avais affirmé avec la gravité d’un conseil auquel je ne pourrais pas échapper : « Il faut vraiment que tu fasses ce livre, ma sœur. » »[14]
« Avec toutes mes sympathies » est un titre qui révèle le ton général donné au livre : une pudique ironie, une détresse retenue qui peine à assourdir le fracas de la colère et du cri, et, surtout, le récit d’une douleur qui ne peut se défaire de l’importance des mots – les siens et ceux des autres, les formules convenues, l’histoire que l’on se construit – pour soi, pour les autres, pour retracer l’histoire d’un lien et d’une famille. Car loin de se contenter de faire la dissection précise de l’aggravation d’une maladie et de son issue funeste, il est avant tout question, dans le roman, de faire se répondre des douleurs irracontables – le décès d’un frère adoré – avec ce que l’amour laisse au moment du départ : l’amour de la littérature et la préciosité des souvenirs.
Ainsi, écrit sous forme d’une espèce de journal intime où la chronologie se retrouve souvent un peu bouleversée, entre enfance et présent, symptômes et pose définitive d’un diagnostic – la disthymie -, soirées mondaines et colère, mer et espoir, Olivia de Lamberterie navigue entre hommage à ses morts, vie qui continue sans scrupules, et difficulté à trouver en soi un petit espace où faire le lit de sa douleur si c’est encore possible. Si, comme je le soulignais plus tôt, on retrouve dans le livre un style qui est bien celui de la journaliste et critique, c’est-à-dire plein de pudeur et d’amour, il est également d’une profonde sincérité et dépose sous nos pas cette vérité terrifiante : il est parfois impossible d’être consolé.
S’épaulant d’une pléthore de références – Jérôme Garcin, plein d’images et de chansons déposées ça et là pour proposer des mots lorsqu’ils ne nous viennent plus -, ce lumineux roman où la tristesse la plus grande côtoie l’espérance la plus violente se fait le récit du deuil, de la famille, de la littérature et de l’absence. Au regard de la difficulté du sujet qu’il aborde – certains passages sur la réalité de la médecine psychiatrique sont assez compliqués à lire, et le suicide reste un sujet possiblement difficile à affronter pour bon nombre d’entre nous -, « Avec toutes mes sympathies » est un livre remarquable en ce qu’il ne verse jamais dans le pathos ou dans le tragique, et qu’il ne côtoie jamais le mielleux ni le niais. Il s’agit d’un récit juste, simplement, en ce qu’il est parfaitement authentique – et je crois sincèrement que la vérité narrative requiert un talent et un courage rare, ce pour quoi ce livre mérité d’être épinglé, et applaudi.
Difficile d’en dire plus, car ce serait aller contre ce qui fait l’intérêt même du livre : ce n’est pas que le sujet importe peu, bien au contraire, mais c’est la beauté avec laquelle il est amené qui fait de ces pages un livre aussi émouvant que splendide. A ce sujet, une dernière chose d’ailleurs : il me semble avoir beaucoup utilisé le mot « pudeur » pour parler de « Avec toutes mes sympathies », et c’est pourtant un contre-sens contre lequel se bat ici Olivia de Lamberterie : il y a certaines choses qui sont trop laides et trop tristes, et saluer qu’on les aborde avec retenue est une violence de plus qui ne rend hommage ni aux morts, ni à ceux qui vivent. Salutaire.
Recueil collectif de recettes d’hiver, Louise Glück
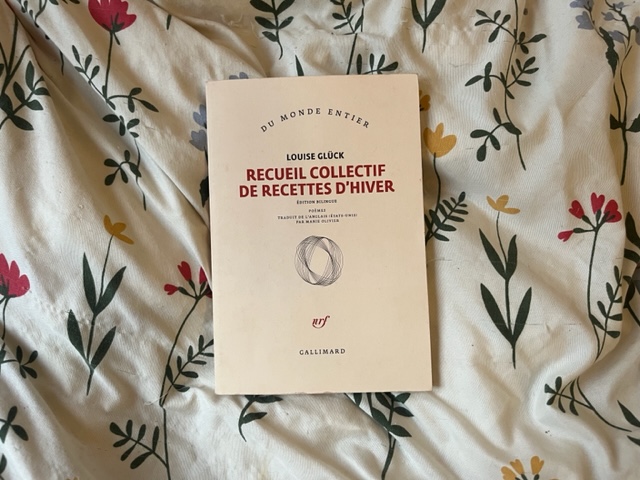
Terminons cet article déjà un peu long avec un recueil de poèmes, découvert récemment et qui a à peu près sauvé une année poétiquement assez morne, en terme de découvertes tout du moins. Mes longues heures de marche de cet été, sur Compostelle, en Île-de-France, en Italie et en Auvergne ont surtout été l’occasion de relire et, pour la première fois, de m’adonner aux joies de la récitation sur les sentiers – Nazim Hîkmet, Apollinaire, Supervielle et Blaise Cendrars surtout ; je signale également au passage l’excellente revue Point de Chute, qui refuse mes poèmes deux fois par an lorsque je les leur soumet, mais à qui je n’en veux nullement car la qualité des textes des auteurices qu’ils publient est selon moi l’une des meilleures du marché éditorial contemporain.
Louise Glück (1943-2023) est une poétesse américaine d’origine juif hongroise et lauréate du prix Nobel de littérature en 2020 pour « pour sa voix poétique caractéristique qui, avec sa beauté austère, rend l’existence individuelle universelle »[15]. En dépit de mon intérêt, dont j’ai déjà parlé plus tôt, pour la littérature américaine et de sa renommée institutionnelle – d’autant que je suis souvent très en accord avec les choix littéraires et poétiques de l’académie Nobel -, je n’avais jamais franchi le pas de m’intéresser plus que de nom et de rumeur à l’œuvre de Louise Glück, et j’avais tort.
A la fin du mois de décembre, comme chaque année, on a organisé dans le café où je travaille un Secret Santa – pour les plus belges d’entre nous, je préfère encore utiliser le terme cacahuète – et, comme chaque année, la pioche du nom, le choix du cadeau et la course collective pour deviner qui avait pioché qui m’ont mis dans un état d’excitation impossible. Deux de mes collègues en particulier, Alizée et Céline, représentantes du bar pour l’une et de la cuisine pour l’autre, avaient mené une compétition acharnée pour découvrir les cacahuètes de tout un chacun, alternant soudoiements, déductions, listes et tableaux ; et c’est ainsi que, le 19 décembre, elles avaient pu avoir une idée plutôt claire de qui avait pioché qui. Alors, quand, à seize heures, l’excitation se trouvant à son comble, notre collègue S. a annoncé qu’elle ne pourrait pas venir ce soir, qu’elle passait son tour et qu’elle était désolée, et que j’ai vu le visage d’Alizée se décomposer en me regardant, j’ai compris assez vite que c’était S. qui m’avait pioché et que je n’aurais par conséquent pas de cadeaux cette année.
J’ai fait de mon mieux pour masquer ma petite déception d’enfant, c’est pas grave, ah ah, après tout ce qui compte c’est le plaisir d’offrir – et puis dans le fond j’étais surtout triste de voir mourir dans l’œuf ce que j’estime être le meilleur moment de ma soirée – non pas de recevoir un cadeau, donc, mais d’enfin découvrir qui nous avait tiré ; et, puisqu’il nous restait deux heures de vaisselle à rincer, me suis concentrée sur la fin de journée.
Quelle ne fut donc pas ma surprise de découvrir, après que nous nous soyons tous gaiment empiffrés de petits fours et autres fromages frits, que deux cadeaux à mon nom trônaient sous le sapin[16] ; je les déballai et découvris que mes collègues – l’une d’elles en particulier, Sonia, si tu me lis merci (ça m’a beaucoup touché) -, face à la catastrophe, avaient couru après leur service dans une librairie pour que j’aie tout de même quelque chose à déballer. Parmi ces deux livres (l’autre est un beau petit livre d’artiste intitulé « Les gens qui font la bringue », avec des dessins très délicats à l’aquarelle), il y avait donc l’édition bilingue du « Recueil collectif de recettes d’hiver » de Louise Glück.
En poésie, j’estime que le charme entre l’imaginaire d’un.e auteur.ice et la sensibilité du.de la lecteur.ice opère immédiatement – il s’exerce dès le premier vers et dès la première ligne. J’étais encore assise dans le canapé de la salle verte de mon café lorsque cet attrait s’est déployé.
Day and night come
hand in hand like a boy and a girl
pausing only to eat wild berries out of a dish
painted with pictures of birds. […]
And then the world goes by,
all the worlds, each more beautiful than the last ;
I touch your cheek to protect you –
Le jour et la nuit arrivent
main dans la main comme un garçon et une fille
s’arrêtant seulement pour manger des baies sauvages dans un plat
décoré de peintures d’oiseaux. […]
Et le monde passe,
tous les mondes, chacun plus beau que le précédent ;
je touche ta joue pour te protéger –
« Poème » dans Louise GLUCK (2023), Recueil collectif de recettes d’hiver, Paris, Gallimard, pp. 12-15.
Ecrit au lendemain de l’attribution du Nobel de littérature, ce recueil est le dernier qu’écrira Louise Glück, décédée il y a quelques mois à peine – et sera publié en français quelques jours après sa mort, alors qu’elle avait été tardivement traduite et introduite au public francophone. Œuvre ultime et courte, donc, où la poétesse au sommet de sa virtuosité reprend certains des thèmes et des ambiances qui auront animé son œuvre comme autant d’obsessions doucement tapies dans la plume. Au travers de quinze pièces, du « Poème » initial au « Chant » qui clôt le recueil, Louise Glück retraverse des atmosphères de contes, où sous prétexte du je, des voix qu’il rencontre et de ses tragédies – celles d’une femme, d’une sœur, d’un concierge, d’un potier -, il s’agit de faire naviguer le lecteur dans des eaux aussi douces et troubles qu’étranges.
Car ce qu’il y a de beau dans la poésie de Louise Glück, qui désigne sans cesse un objet qui ne peut se voir, tient précisément dans l’exacerbation du caractère évasif de la poésie appliquée à chacun de ses niveaux sémantiques. Dans un bel article publié dans la revue L’Atelier, sa traductrice française, Marie Olivier, analyse deux de ses poèmes (issus respectivement de Meadowlands (1996) et de Faithful and Virtuous Night (2014)) et pointe du doigt cet atmosphère ineffable de l’écriture de Louise Glück en ces termes : « […] l’effacement vient en parallèle avec une incarnation littérale du sens. De la même manière, […] est incorporée dans un récit tout en se projetant simultanément dans le gouffre de son propre silence, dans la confession d’un secret qui jamais ne se dit »[17].
Dans son « Recueil collectif de recettes d’hiver », cette atmosphère de silences diffus pare ses inavoués d’un travail allégorique et sémiotique autour des topos cosmiques de l’hiver – genièvre, feu et vent. Si le travail sur la place de l’homme dans l’univers est au centre de l’œuvre de Glück de la même manière que l’infusion dans le beau des mots du quotidien – de tous les mots et de chaque réalité, jusqu’à la plus minuscule, jusqu’à la plus triviale -, ce recueil en particulier aura été une lecture poétique idéale pour conclure froidement cette année.
Conclusion sous forme de confession d’une étrange obsession littéraire : Emmanuel Carrère
Avant de conclure cet article qui, une fois de plus et en dépit de mes efforts, commence à prendre des allures interminables, je me sens le devoir d’aborder avec vous un morceau important de ma rétrospective de lectures de cette année : ma phase Emmanuel Carrère, ou mon Emmanuel Carrère Era pour les plus Gen Z d’entre nous. Comme je le mentionnais au début de ce papier, cette année en particulier aura été marquée par une succession de périodes d’intérêt aussi intenses qu’hermétiques (toute une série d’écrits de femme à propos de l’amour, ma névrose pour l’agroalimentaire, quelques courts jours de passion pour la médecine et la philosophie ayurvédique, etc., etc.) et parmi elles une a été plus longue et plus investie encore que les autres : j’ai nommé mon mois de septembre, que j’ai tout entier passé à lire Emmanuel Carrère.
L’intention au départ, c’est peu le dire, était bonne. Comme pour beaucoup d’entre nous, Emmanuel Carrère a été durant ma jeunesse une sorte d’incontournable de la littérature française contemporaine, c’est-à-dire plus précisément que dans la bibliothèque parentale, première réserve de savoir des adolescents-lecteurs, on trouvait D’autres vies que la mienne et La Moustache. J’avais lu La Moustache à peu près au même moment que Le Nez de Gogol, et je dois avouer que j’avais tellement aimé le premier qu’il avait presque surpassé le second. Puis le temps avait passé et Emmanuel Carrère (vous connaissez dorénavant mon historique vis-à-vis des auteurices contemporain.e.s) avait retrouvé sa place de nom à peu près connu et auquel on ne s’intéresse que peu.
Puis, début septembre, je suis partie à La Ciotat une semaine, avec la noble idée de faire une petite retraite d’écriture dans un camping. Un matin, je me suis rendue à la librairie du Port et me suis rappelé que mon père, toujours en lien avec ma monomanie catholique, m’avait conseillé de lire Le Royaume. Dans ce récit, dont la qualité scientifique et la véracité historique a été validée par la plupart des universitaires qui se sont penchés sur sa lecture, Emmanuel Carrère se propose de retracer à la façon d’un enquêteur les premières années du christianisme primitif, c’est-à-dire les alentours du Ier siècle, en se penchant sur les écrits et la figure des apôtres Paul et Luc. Succès de ventes et d’estime à l’époque, Le Royaume a effectivement été pour moi une lecture très agréable, et plus encore sa première partie, intitulée « Une Crise (1990-1993) » où Emmanuel Carrère narre et confesse sa propre expérience intensément catholique. Cette première partie plus encore, car au contraire des deux suivantes (qui se concentrent d’abord sur Paul puis sur Luc) où l’écriture se colle – et se doit de coller – à un certain niveau de véracité historique, le récit autofictionnel de la crise religieuse m’a reconfrontée à l’aisance stylistique de l’auteur et à mon intérêt pour les histoires de vie.
Et c’est ainsi que, un mois durant, je n’ai lu tout simplement que Emmanuel Carrère, achetant et dévorant ses livres les uns après les autres. L’Adversaire, d’abord, qui raconte l’affaire et le procès de Jean-Claude Romand ; D’autres vies que la mienne, que je relis ; Il est avantageux d’avoir où aller, un recueil d’écrits variés et d’articles ; Un roman russe, qui a été une lecture marquante – j’y reviendrai – ; et, enfin, Yoga, à propos duquel je n’avais pas manqué, il y a quelques années, la polémique.
J’ai lu Yoga assise par terre dans la poussières entre trois tentes à la fête de l’Huma, ne pouvant m’arrêter de tourner les pages et de lire ; et c’est pourtant ce dernier roman qui à mon sens, et d’un point de vue proprement littéraire, s’est avéré de plus en plus décevant au fur et à mesure des chapitres, a signé le début de la fin de ma « période Emmanuel Carrère » (c’est comme sa crise religieuse : elle se délimite nettement et peut faire l’objet d’un chapitre). Comme je le disais, j’avais vaguement suivi, à l’époque de sa publication, la polémique qui avait fait ses vagues dans les milieux du journalisme littéraire, sans m’y intéresser outre mesure. Pour la résumer brièvement, car je me suis bien entendu repenchée dessus depuis, elle tient à la frontière fine entre réalité et fiction dans ce récit qui se présente comme autobiographique. En effet, la journaliste Hélène Devynck, ex-compagne d’Emmanuel Carrère, a dénoncé dans une très belle tribune que je vous engage à lire, la façon dont l’écrivain a dérogé à leurs accords de confidentialité préétablis pour nourrir son roman à sa défaveur. Elle y livre une réflexion passionnante sur la façon dont les hommes se servent des femmes pour écrire, et dont cela peut vite devenir une violence conjugale typique[18].
En raison de ma sensibilité, ces propos résonnent fort, et frappent d’autant plus que Yoga a précédé la lecture d’Un Roman Russe, qui m’a laissé un sentiment très déplaisamment ambigu. Dans une critique que je ne retrouve plus, un lecteur disait de ce dernier roman qu’il était probablement le plus réussi d’Emmanuel Carrère dans la mesure où c’était celui où l’auteur se présentait de la manière la plus désagréablement authentique – exhibant une lucidité totale vis-à-vis de ses vices et de son propre narcissisme, ce parfait discernement allant même jusqu’à transcender le narcissisme propre à l’autodissection – ; et je suis d’accord avec cette critique. Mais tout de même, et en dehors du talent que je lui reconnais, ainsi que de ce que je reconnais de moi en lui, il y a dans Un Roman Russe, qui est en partie l’histoire d’un amour qui se déchire, une violence sexiste et classiste presque perverse qui me semble aujourd’hui impossible de ne pas voir et surtout dénoncer.
Je n’irai pas plus loin dans le commentaire d’Un Roman Russe car ça pourrait faire l’objet d’un article entier, mais le fait est que cette lecture m’a laissé un goût un peu amer et a, donc, compliqué mon rapport à Emmanuel Carrère (c’est le moins qu’on puisse dire). Comment faire le bilan de mes lectures de l’année sans parler de mon intérêt pour son œuvre – et comment parler de son œuvre sans mentionner tout ce que j’y réprouve ? Il serait intéressant, me semble-t-il, de proposer une réflexion plus complète au sujet de ces artistes que l’on aime et qui, à un instant ou l’autre, nous laissent seuls avec notre amour et ce que nous impose les frontières de notre éthique. Quoiqu’il soit aujourd’hui difficile à chacun d’entre nous d’occulter ces questions cruciales, et que je n’y aie bien entendu pas échappé à plusieurs moments de ma vie, sachez qu’il s’est agi d’un gros morceau de mes réflexions personnelles et littéraires en septembre, mais qu’elles n’effacent pas les beaux instants de lecture qui l’ont traversé.
Il est maintenant temps de m’arrêter avant de me retrouver à déblatérer encore en avril sur ces lectures qui auront impacté l’année 2023, et de recommencer à lire.
En espérant vous retrouver l’année prochaine avec plein de nouvelles idées et mots imbibés et appris, je vous souhaite à tous et à toutes des prochains mois exaltants, sains, et poétiques.
Alice.
[1] Tout arrive
[2] C’est vrai et faux : j’ai totalement dépassé ma période d’obsession pour le sujet, mais sans rien oublier de ce que j’en ai appris, dont beaucoup de choses scandaleuses. A ce sujet, je vous invite plus que vivement à lire « Les Algues vertes », évidemment, mais aussi « Le livre noir de l’agriculture » d’Isabelle Saporta, qui est édifiant, et surtout « Vous êtes fou d’avaler ça » de Christophe Brusset : le titre est racoleur mais le livre est très bien et ce qu’il raconte est aussi instructif et utile qu’anxiogène et terrifiant.
[3] Et ici je dis malheureusement bien auteur car je n’ai pas lu beaucoup de femmes à l’époque.
[4] https://www.lefigaro.fr/livres/2007/09/13/03005-20070913ARTFIG90218-dans_la_peau_de_zelda.php si vous voulez en savoir plus sur le sujet, un article intéressant sur le sujet et dont la lecture est en accès libre.
[5] Il y a, en fait, une erreur de traduction dans le titre français original : théoriquement, le titre correct devrait être « Les Beaux damnés » (dans The Beautiful and Damned les deux adjectifs sont en fait coordonnés et ne désignent pas deux groupes indépendants). Aujourd’hui, la tradition française a retenu « Les Beaux et les Damnés », mais pour des questions de préférence et de lisibilité je conserverai ici le titre des premières éditions.
[6] Mix de « La Boucle des impressionnistes » et de « Aux sources de l’inspiration de Vincent Van Gogh », environ 23km au départ de la gare d’Auvers-sur-Oise. Le profil IGN est disponible sur l’application Visorando et c’était très sympa, je recommande.
[7] Très honnêtement sans doute à cause de l’aspect un peu vieillot des couvertures de la plupart de ses livres.
[8] Ca ne va malheureusement toujours pas de soi, ce qui n’aura de cesse de m’étonner.
[9] J’espère vraiment que vous lisez mes notes de bas de page car « La Mère morte » fait également partie de mes lectures préférées de l’année : c’est un livre aussi agréable que juste et bouleversant, qui traite entre autres de l’Alzheimer de Benoîte Groult, de la transmission entre femmes, du statut de mère et de fille. Lisez-le !!! C’est passionnant !!!
[10] La composition ayant été dirigée, donc, par Blandine de Caunes.
[11] Que j’avais pour projet de visiter lors de mon dernier séjour en Irlande, vers Cork : au final, le trajet s’est révélé trop compliqué pour le peu de temps que je passais sur place – à mon grand regret, car la région a l’air magnifique (je vous invite vivement à taper Beara Bay sur Google Image pour en avoir un renversant aperçu).
[12] Pour d’obscures raisons que j’ignore, l’épisode n’est plus disponible sur Spotify mais j’ai réussi à en retrouver la trace à l’adresse suivante : https://www.ktotv.com/video/00300417/francois-begaudeau. C’est passionnant, si vous le pouvez, écoutez cette intervention !
[13] BEGAUDEAU François, ROSE Sean (2018), Une Certaine inquiétude, Paris, Albin Michel, p. 16
[14] DE LAMBERTERIE Olivia (2018), Avec toutes mes sympathies, Paris, Stock, p. 19.
[15] https://information.tv5monde.com/terriennes/deces-de-la-poetesse-americaine-louise-gluck-prix-nobel-de-litterature-2020-36957#:~:text=Voici%20ce%20qui%20disait%20d,l’existence%20individuelle%20universelle%22.
[16] Bon, là je fabule, il n’y avait pas de sapin, mais on avait mis les cadeaux sous une plante et franchement c’était tout comme.
[17] OLIVIER Marie (2015), « Le chant en réserve : lecture de deux poèmes de Louise Glück », dans L’atelier : Réserve, vol. 7, no. 2, p. 16.
[18] https://www.lemonde.fr/livres/article/2020/11/26/controverse-autour-de-yoga-d-emmanuel-carrere-je-ne-veux-pas-etre-ecrite-contre-mon-gre-affirme-helene-devynck_6061254_3260.html le contenu de cet article est réservé aux abonné.e.s du monde mais je me ferai un plaisir de vous en faire des captures d’écran si vous le souhaitez.

Recueil collectif de recettes d’hiver me semble super intéressant
J’aimeJ’aime